[Cultissime] Peut-on vraiment faire du manga à la française ?
Les 27 au 29 septembre 2024 se tenait Cultissime, un nouveau festival dédié aux œuvres cultes à Angers. Le samedi se tenait la table ronde, animée par le journaliste manga Valentin Paquot : « Peut-on vraiment faire du manga à la française ?« . Deux mangakas, Yoann Vornière (Silence) et Shonen (Dark Souls Redemption, Outlaw Players) ainsi que le scénariste Julien Blondel ont livré leurs réponses sans oublier de donner de précieux conseils pour se lancer dans le manga en France !
Nous vous proposons notre retranscription de cette conférence XXL, mais passionnante à plus d’un titre. Bonne lecture !

Présentation des invités
Valentin Paquot (présentateur) : On commence par toi, Julien. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement ?
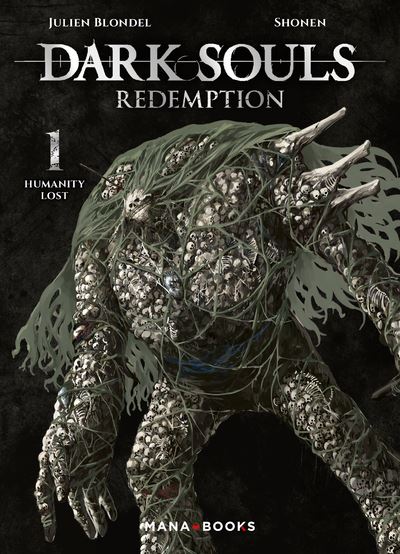
Julien Blondel : Avec plaisir. Julien Blondel. Je suis scénariste et auteur de jeux de rôle à l’origine. J’ai commencé en 1994 pour Casus Belli [NDLR : magazine francophone traitant du jeu de rôle abrégé JDR]. J’ai travaillé dans l’univers du jeu de rôle pendant un petit moment et je suis rentré chez Les Humanoïdes Associés pour faire l’adaptation en jeu de rôle des Méta-Barons… Et j’ai découvert la bande dessinée à ce moment-là. J’ai commencé à faire du scénario de BD avec le lancement d’une première collection de mangas français qui s’appelait Shogun, des prépublications par chapitre, géré par Guillaume Dorison où Shonen a fait ses premières créations. J’ai fait mon premier manga à cette époque-là et j’ai fait beaucoup de bandes dessinées depuis. Je reviens au manga avec l’adaptation du jeu vidéo Dark Souls avec grand plaisir parce que c’est un format qui est très particulier pour raconter des histoires.
Valentin Paquot : On reparlera un peu plus tard de Dark Souls. Bref, tu as une grosse casquette en adaptation et des capacités à t’approprier des univers et à les porter dans un autre médium.
Julien Blondel : C’est devenu une partie importante de mon métier. On en reparlera tranquillement. On présente maintenant Yoann Vornière.
Valentin Paquot : Yoann, toi aussi tu as un parcours assez long…
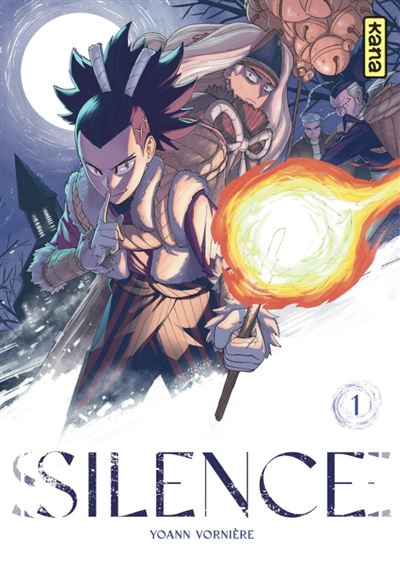
Yoann Vornière : Ouais, en gros j’ai commencé avec la BD, Jill & Sherlock chez Ankama en 2017 avec Jim Bishop comme scénariste. Et j’ai eu un parcours semé d’embûches jusqu’à aujourd’hui travailler sur Silence chez Kana, un manga où je suis aujourd’hui dessinateur et scénariste.
Valentin Paquot : Le manga est la bande dessinée qui vient du Japon et qui a un format très particulier parce qu’il y a un très grand nombre de pages, puisque cela vient de périodiques de prépublication, en général hebdomadaires pour les plus connus. Est-ce que vous pensez, en tant qu’auteurs, que c’est un un rythme possible de publier 10 à 20 pages par semaine ?
Yoann Vornière : Aujourd’hui, cela ne serait pas possible. Cela ne veut pas dire que ce n’est pas envisageable. Il faut voir en fait les systèmes mis en place au Japon. Les mangakas ont beaucoup d’assistants et des éditeurs disponibles et prévus pour que le rythme soit bon et tenu. En France, on ne fonctionne pas du tout comme ça car il y a le droit du travail. En termes de gestion du temps, des horaires et tout, c’est complètement différent. Au Japon, il y a aussi les mensuels et je pense que le rythme français s’en rapproche le plus.
Valentin Paquot : Vous êtes rentrés tous les 2 par l’univers de la BD d’abord. À quel moment le premier manga que vous avez lu est arrivé dans vos mains ? Et à quel autre moment vous êtes-vous dit : « Wow, le manga c’est génial ! » ?
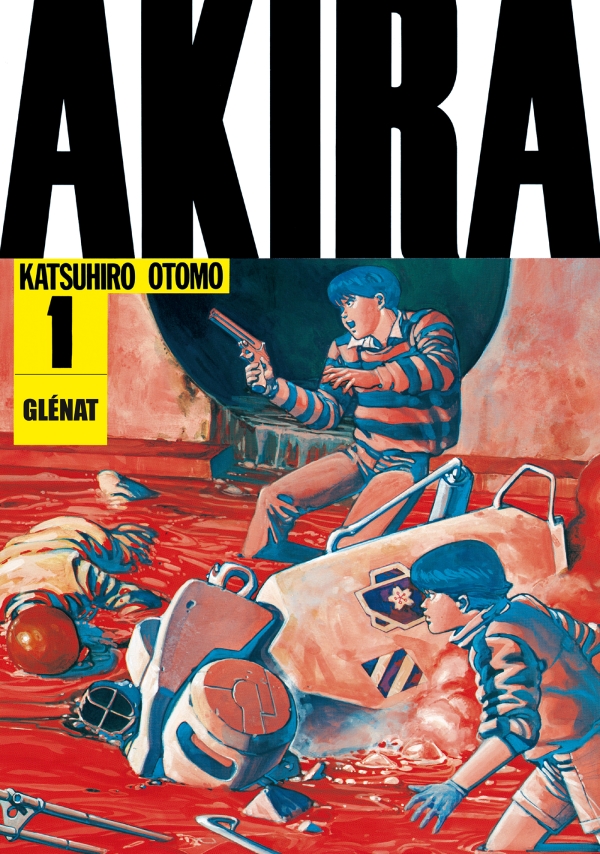
Julien Blondel : Pratiquement en même temps pour le coup. Je n’étais pas trop lecteur de bandes dessinées à l’origine. Je lisais les Astérix, Thorgal, XIII des parents. Je n’avais pas forcément une grosse culture BD. Juste une connaissance de la BD grand public limitée aux grosses séries comme les Tintin et Astérix. Mais la bande dessinée, c’était aussi déjà des univers très particuliers. Cela allait jusqu’à Métal Hurlant. Il y avait de la science-fiction… Et j’ai vraiment découvert le manga et la bande dessinée en même temps en arrivant chez « Les Humano » ou un tout petit peu avant. Je suis de la génération qui a vu arriver Akira en manga périodique, en petit fascicules. Je les ai encore et ça c’est super. Et j’ai découvert l’objet manga avec les premiers Akira, typiquement des œuvres en format assez grand en France.
(Shonen arrive sous les applaudissements du public)
Julien Blondel : Le premier manga qui m’a marqué et mis la première claque, à part l’arrivée du long métrage Akira et le fait de le voir en manga imprimé (il y avait la version couleur aussi), c’est Dômu (Rêves d’enfant en français) de Katsuhiro Ôtomo. Il l’avait fait juste avant Akira, une histoire d’êtres dotés de pouvoirs psychiques dans un quartier avec des blocs HLM. Tu te rends compte que juste avec le découpage et le cadrage, le mangaka arrive à te donner l’impression que ces personnages volent/flottent. Et tu te dis que l’on peut faire ça en bande dessinée. Il y avait pas de différence entre le manga et la BD franco-belge parce que les deux racontaient une histoire par le dessin, au final. Et il y a beaucoup d’influence mutuelle entre la France et le Japon. Moebius et Miyazaki se renvoient souvent la balle artistiquement parlant.
Il y a une culture qui est quand même assez mixte et j’ai découvert au même moment que l’on pouvait raconter des histoires en BD et en manga. Et ensuite, en creusant les 2 médias et les 2 cultures différentes, tu te rends compte qu’il y a des auteurs, des œuvres, des formats qui sont distincts, mais qu’à l’origine le coup de cœur est simultané sur les 2 médias.
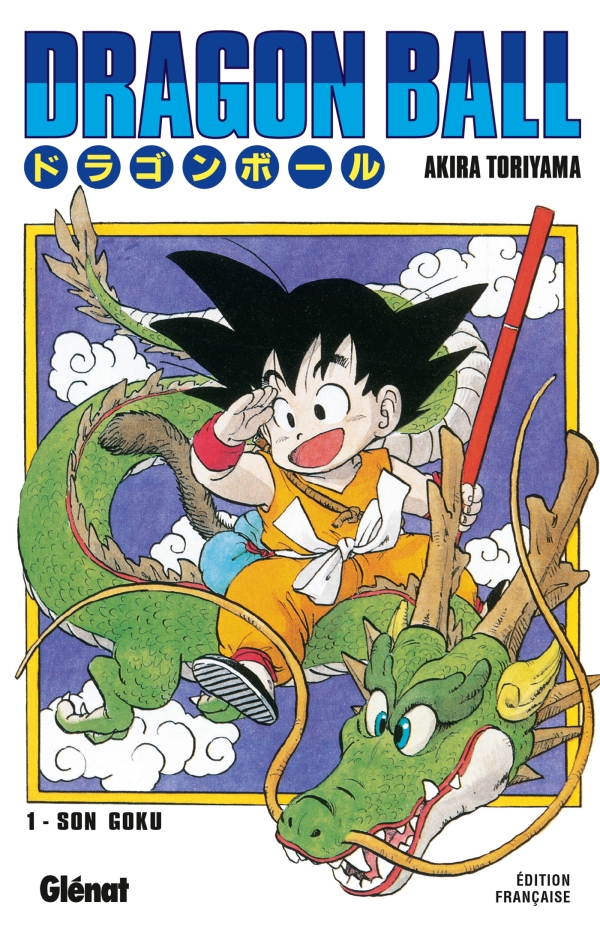
Yoann Vornière : C’est assez marrant parce qu’à l’époque, comme c’était édité en grand format et en sens de lecture française, il ne devait pas y avoir tant de différences que ça, à part les différences culturelles. Pour ma part, j’ai découvert le manga en kiosque plutôt avec Dragon Ball et Pokémon – La grande aventure dans un autre format, en demi-tomes. À partir de là, j’étais accro et Dragon Ball, en fait, c’était ma génération. On ne pouvait pas y échapper quoi. C’était vraiment partout : les sacs à dos Dragon Ball, les chaussures Dragon Ball, tout était Dragon Ball… Cela m’a donné envie de dessiner et donc de m’intéresser aux mangas.
Valentin Paquot : On va te présenter très rapidement Shonen, celui qui a pris le pseudo d’auteur le plus difficile à retrouver sur Google.
Shonen : Et fier de l’être.
Valentin Paquot : Est-ce que tu peux juste te présenter très brièvement et nous expliquer à quel moment tu es tombé dans le manga ?
Shonen : Voilà, je m’appelle Shonen et j’ai suivi un parcours relativement atypique, c’est-à-dire qu’à la base je ne me destinais pas au manga mais plutôt au jeu vidéo. Et ma carrière de mangaka a commencé par hasard, je dirais. J’ai travaillé pour 3 éditeurs. J’ai été chez Les Humanoïdes associés avec BB-Project puis Omega complex. Ensuite, je suis parti chez Pika où cela ne s’est pas bien passé avec Lords of Chaos. Je travaille actuellement sur Outlaw Players qui est en 13 volumes chez Ki-Oon et Dark Souls chez Mana Books.
BD et mangas : ce qui les différencie
Valentin Paquot : Et on peut dire que tu es le premier, en tout cas ici, à avoir ton manga aussi publié au Japon. C’est donc un manga à la française publié en japonais. On va maintenant rentrer un peu dans le détail de la création de manga qui n’est pas du tout le même médium que la bande dessinée. Certes, c’est très proche, mais en même temps très différent. C’est beaucoup plus verbeux. Il y a plus d’action vu qu’on a droit à plus de pages.
Comment est-ce que vous abordez, vous, ces différences ? Et Julien, tu nous donneras ton point de vue : est-ce que tu es un scénariste sadique où tu demandes à ton dessinateur 1 532 personnages dans une case ?
Julien Blondel : Sadique, non. C’est vrai que les formats sont différents. Je suis scénariste : j’ai fait de la série télé, du long-métrage, du jeu vidéo, du jeu de rôle… Tu racontes en fait la même histoire mais de façon différente. Tu vas la découper et l’adapter à la taille des pages et à leur nombre mais aussi leur médium. Par exemple, les comics sont classiquement divisés en petits chapitres parce qu’ils font l’objet de publications morcelées qui sont ensuite compilées dans des trade paperbacks en dur. À mon avis, ce qui différencie vraiment la BD et le manga, c’est le rythme de publication avec un engagement de publier un nombre de pages par semaine ou par mois. Et tout s’organise autour de ça.
Ce rythme va déterminer ton rythme de travail. Contrairement à la BD où un dessinateur réalise 5 à 8 planches par mois en moyenne pour le format franco-belge de 46-54 pages aun final, pour les mangas, le mangaka, leurs assistants et leurs ateliers s’organisent pour fournir soit 10, 12 ou 15 pages par semaine, soit un chapitre entier d’une trentaine de pages par mois. Dès le début, tu organises, selon le rythme de production et de publication, le découpage de l’histoire en chapitres, en albums et le rythme de narration. Ce n’est pas sexy de dire que quand t’attaques une œuvre en manga ou en BD, c’est le côté travail et publication qui prime au début. Ensuite, tu es dans l’artistique, dans l’esthétique et tu vas raconter l’histoire. Mais au départ, c’est vraiment le format et le rythme qui compte, avec son organisation du travail pour pouvoir tenir les délais et livrer les pages.

Valentin Paquot : Est-ce que, du coup ,savoir jusqu’où vous allez pouvoir aller ne serait-il pas le premier petit confort dans la réalisation du manga à la française ? Quand on commence un manga au Japon, on ne sait pas si la série va être arrêtée au bout de 3 semaines, 2 ou 6 mois. En France, il y a des contrats pour plusieurs volumes. Est-ce que c’est frustrant de ne pas savoir que vous pouvez raconter une histoire pendant 10 ans ? Ou est-ce que c’est plutôt satisfaisant de savoir que vous avez 3 tomes et que vous allez pouvoir vous exprimer, raconter un arc narratif complet ?
Yoann Vornière : Je pense que dans l’absolu c’est toujours frustrant, même si effectivement au Japon, cela peut être arrêté beaucoup plus brutalement. Je pense que quand on fait du manga, ce qui prime c’est l’envie de raconter quelque chose qui prend du temps à dessiner. En France, un rythme intense pour un auteur est de réussir à faire 2 tomes par an. Sachant que, 2 tomes par an, pas tout le monde y arrive. Au Japon, si on prend le Jump classique, c’est 5-6 tomes. En fait, l’échelle de temps n’est pas la même. En 5 ans en France on va dire que c’est un peu moins d’une dizaine de tomes. Au Japon, en 5 ans, il peut déjà y avoir des séries finies. Les carrières sont donc complètement différentes.
En termes d’écriture, il est important de réfléchir et de tenir compte du rythme de publication. Dans le cas de prépublication, en hebdomadaire ou en mensuel, le cliffhanger peut permettre de tenir une semaine ou un mois. Quand on fait un manga qui sort en France, il faut que le cliffhanger tienne le lecteur pendant 6 mois voire 1 an.
L’impact du rythme de publication et de l’objet livre
Valentin Paquot : Est-ce que vous êtes aussi moins tributaires d’avoir un cliffhanger à chaque chapitre et est-ce que vous priorisez celui de la fin de volume ? Ou est-ce que vous continuez quand même à avoir des pics, comme ce que recommande Orson Scott Card [NDLR : auteur du Cycle d’Ender] à chaque chapitre pour être cyclique et garder le lecteur jusqu’au bout ?
Julien Blondel : Je pense qu’on peut aussi comparer ça aux séries télévisées. En fait, ce sont des formats, des histoires qui sont dès le début calées avec un certain nombre d’épisodes. Quand on lance un projet de série TV, de BD ou de manga, nous avons des personnages et l’envie de raconter leurs histoires. Tout de suite, nous allons essayer de se dire en combien de tomes ou d’épisodes et saisons nous allons pouvoir travailler. C’est une promesse faite au lecteur ou au spectateur.
Si l’on sait dès le début que ça va être 2 saisons de 6 épisodes avec un an d’écart entre les deux, il faut frapper fort à la fin de la première saison pour que les gens attendent ou aient envie d’attendre un an. Et si, par exemple, la série entière est diffusée d’un coup, tu n’es pas obligé de mettre le même suspense à la fin de chaque épisode. Et si c’est une série chorale avec 14 personnages, il faut peut-être résoudre certains arcs narratifs pendant une saison et en ouvrir d’autres.
C’est le rythme de diffusion et le genre de l’histoire qui sont déterminants. Tu ne vas pas attendre le même cliffhanger : accroché à une corniche, est-ce qu’il va mourir ? À la fin de chaque tome, cela serait répétitif. Les lecteurs ont aussi des fois envie d’avoir des cliffhangers plutôt émotionnels, un personnage qui change ou une fin un peu plus paisible. Et ce n’est pas pour ça qu’ils ne vont pas attendre la suite si les personnages sont laissés dans un état où on veut continuer à les suivre. Il n’y a pas de systémisme. Cela va aussi dépendre du découpage de la série et du rythme de publication encore, je pense.
Valentin Paquot : Une autre grosse différence entre le marché français et le marché japonais, c’est qu’au Japon, le manga est conçu comme un produit 360, c’est-à-dire pour être accompagné en dessin animé, avec la vente de jouets, de chaussures, de sacs à dos… En France, cela n’est pas le cas. Quoique. Avec Dark Souls, vous travaillez sur l’adaptation en manga d’un jeu vidéo. Est-ce que cela fait une différence dans la manière de construire et d’expliquer un univers, de savoir que vous n’allez pas pouvoir rebondir sur d’autres formats ?

Yoann Vornière : Le fait d’avoir tous ces goodies, c’est un peu une manière de continuer d’accrocher le lecteur entre deux publications. Au Japon, ils n’ont qu’une semaine à attendre et avec les goodies, dans l’esprit des lecteurs, ils ont toujours de quoi être satisfaits et attendre une semaine uniquement. Aujourd’hui, en France, il y a tellement de sorties de BD et d’œuvres de divertissement que c’est très dur. À la fin d’un tome, le lecteur doit conserver la même envie de lire et d’attendre 6 mois avant la sortie du prochain volume.
La double-page en manga, qui est différente en webtoon forcément, peut être un mini cliffhanger et donner envie de la tourner. Ce n’est pas systématique mais cela aide aussi à avoir une narration fluide. Par exemple, dans l’écriture de série, à chaque scène il doit y avoir un mini cliffhanger pour amener à la scène suivante. Je sais que je m’amuse à en mettre, en fin de chapitre, pour rythmer le récit dans le tome. Le gros cliffhanger est en général à la fin du tome.
Valentin Paquot : Du coup, aujourd’hui, quand vous réalisez votre manga, vous privilégiez la lecture physique et pas encore la lecture sur smartphone où il n’y a plus cette double-page affichée ?
Yoann Vornière : Oui, enfin, en tout cas pour moi, c’est une spécificité du manga donc c’est un élément sur lequel je vais être très regardant.
Julien Blondel : Oui, parce que je pense aussi qu’on fait du livre la finalité première. Et je réponds aussi à ta question sur le trans-média, le fait de développer et de penser un projet sur plusieurs supports. Mais lorsque l’on se lance dans un projet de manga, un roman ou une bande dessinée, nous avons que nous travaillons pour un objet imprimé parce que c’est ce que nous voulons obtenir, même si nous nous doutons qu’il y aura aussi des lectures en ligne. Si le projet est de développer du contenu spécifiquement à la lecture en ligne, au smartphone et au scroll par exemple, il faut le penser autrement pour s’adapter au support, aux écrans de tailles différentes, au rythme de lecture et le fait de pouvoir y avoir accès n’importe quand.
Nous travaillons en premier lieu pour un objet livre, imprimé, que l’on peut tenir en main. Dès que l’on tourne une page, on va voir la double-page en entier. On voit en premier ce qui est en bas à droite, même si on est en lecture japonaise. Il y a donc des contraintes comme ça, de format, qui font que l’on doit travailler sur l’histoire pour l’impression. Et après elle peut être aussi pensée en disant « tiens, cette page-là, elle rendra jamais si on la fait en lecture en ligne ».
Trans-média, adaptation et manga original
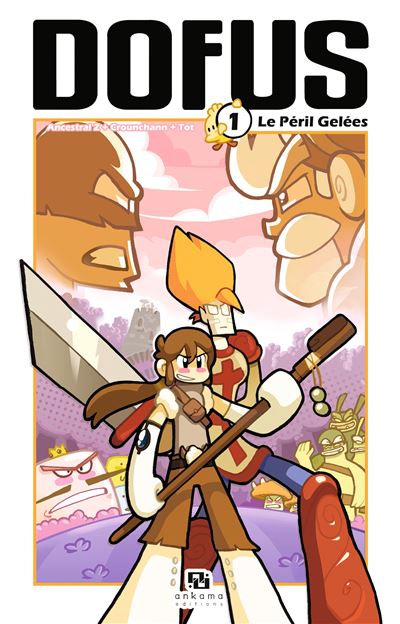
Julien Blondel : Il y a des projets qui sont pensés dès le début comme étant trans-média. Ankama est un exemple à la française très inspiré par la culture japonaise. Pour l’univers de Dofus, ils ne se sont interdits aucun développement. Ils l’ont fait dans un certain ordre mais les mangas Dofus sont un des moyens de lire, avoir des émotions dans l’univers global de Dofus. Cela a commencé par le jeu en ligne. Il y a eu des peluches, des conventions où on pouvait jouer au Boufbowl en live… Tout ça, c’est une approche globale.
Il y a aussi des livres qui sont pensés pour être uniquement un livre et c’est tout. Je sors un peu du manga mais il y a des auteurs mythiques de polar comme James Ellroy que nous avons a eu la chance d’avoir hier au festival Cultissime. On n’a pas forcément envie d’avoir un mug James Ellroy ou L.A. Confidential [NDLR : roman de James Ellroy adapté ensuite en film]. Il fait un roman et bam, ça va peut-être faire un excellent film après ! Après nous, sur Dark Souls, nous devons intégrer certaines contraintes car nous adaptons l’univers de plusieurs jeux vidéo en manga. Le fait de savoir qu’il n’y aura pas de peluches Dark Soul Redemption après, cela ne change pas notre manière de travailler. Nous sommes vraiment sur l’univers, l’histoire et la restitution graphique.
Valentin Paquot : Quand on crée une œuvre, il y a toujours énormément d’ébauches et d’essais. Comment est-ce que vous savez aussi bien scénaristiquement que graphiquement, que ça y est, vous tenez la bonne version ? Que cette 14e version, c’est la bonne ? Shonen, tu montes jusqu’à combien de versions pour certains personnages ?
Shonen : Je dirais que c’est très variable en fait parce que, au final, il faut une validation des ayants droit japonais. Parfois, il faut 4-5 versions mais c’est le prix à payer pour travailler sur une licence. Il y a une charte graphique à respecter et c’était la première fois que je travaillais sur une licence de dark fantasy.

Valentin Paquot : Si tu compares justement le travail sur Dark Souls et celui sur Outlaw Players qui était ta propre création à 100%, est-ce que tu as senti que ces contraintes finalement te guidaient et que tu étais moins perdu parce que t’avais moins de possibilités… ou est-ce qu’au contraire tu t’es plus éclaté sur Outlaw Players ?
Shonen : Je dirais que c’est un peu biaisé parce que forcément je prends plus de plaisir sur un projet qui est plus personnel et où je suis le seul maître au niveau des designs et des concepts que je propose. Sur Dark Souls, c’est plus compliqué mais d’une certaine manière, je dirais que c’est une expérience nouvelle et enrichissante.
Valentin Paquot : Yoann, du coup, toi qui a présenté un projet à un éditeur français, dans ce processus créatif, quand est-ce que tu as su qu’il était abouti ? Et à quel point le projet a été modifié avant la première publication ?
Yoann Vornière : Il y a une phrase un peu toute faite qui dit que c’est terminé quand on décide de s’arrêter. Je pense que c’est vraiment ça. Je sais qu’il y a des auteurs, notamment de BD qui ont refait leur tome encore, encore et encore et qui finalement tombent dans une boucle infinie et refont la même chose. Le temps passe et les dessinateurs ont une nouvelle vision et de nouvelles influences qui font que son projet évolue avec le temps.
Et c’est assez marrant de voir que, quand on regarde un manga japonais dont le rythme de parution est comme je le disais beaucoup plus rapide, il y a une vraie différence si on regarde entre le tome 1 et le tome 10. Cela n’a pris qu’un an et demi et si on compare avec le manga français, on peut avoir aussi cette sensation d’évolution mais en seulement trois tomes d’écart. C’est donc tout le temps en train de bouger avec de nouvelles influences et envies, même si le projet était très cadré au départ. Je pense que pour des mangas qui sont comme ça, qui veulent durer dans le temps, si on commence à se dire « non, ma base c’était celle-là, il ne faut pas que j’en bouge », en fait, on ne fait jamais le tome suivant et on dit « non, ça ça m’embête et j’avance et je préfère faire autre chose ».
Gérer la solitude et le rythme
Valentin Paquot : Une autre différence entre les 2 univers japonais et français, que vous avez évoqué tout à l’heure, c’est la présence d’assistants et d’éditeurs dédiés qui passent des coups de fil toutes les semaines. Il y a certaines anecdotes d’éditeurs qui passent 7 h au téléphone avec leur mangaka pour discuter d’un chapitre. Est-ce que, quand on est mangaka ou auteur français, on ressent une sorte de solitude, d’isolement ?
Yoann Vornière : Euh… oui.
Valentin Paquot : Comment on fait quand on se lève pour se dire « ok la page est blanche, aujourd’hui je fais 3 pages » ? Comment on gère son rythme ?

Yoann Vornière : Alors, il y a plusieurs sources de motivation. Premièrement, l’argent, à ne pas négliger. En fait, ça dépend des contrats mais en général, l’auteur a une somme d’argent par tome. En fonction du rythme, l’argent est donc étalé sur 1 an ou sur 6 mois. Et forcément si c’est sur 6 mois, cela met du beurre dans les épinards. Rien que cela, c’est déjà très motivant. Mais il y a aussi, et c’est plus chouette, quand on travaille dans la BD, on a envie de raconter une histoire et d’aller à la suite. Une fois le tome terminé, le plus motivant est de se dire que l’on continue un peu plus chaque mois l’histoire que l’on a en tête depuis 2021 pour moi.
Je sais qu’il y a des auteurs qui ont le syndrome de la page blanche. En tout cas pour mon cas, comme je sais où je veux aller et que cela me donne envie d’y aller, naturellement, j’ai ce rythme pas très rapide comparé à d’autres dessinateurs mais très régulier parce que j’ai envie d’atteindre cet objectif rapidement, tout en prenant du temps pour le dessin et en me faisant plaisir… et en trouvant mon équilibre.
Valentin Paquot : C’est quoi pour toi un dessinateur rapide ? C’est combien de pages par jour ?
Yoann Vornière : Moi en gros, je fais 10 pages par semaine. Par mois, cela fait entre 35 à 40 pages, suivant les dédicaces, etc. Cela représente un rythme hebdomadaire au Japon mais il y a des dessinateurs qui peuvent faire 20 pages en une semaine. Souvent en France, ce genre de profil, quand ils sont tout seul, ils vont faire 20 pages en une semaine, puis la semaine d’après 2 pages, puis après 10 pages et ça va être très irrégulier. Moi, je me suis dit : « 10 pages par semaine, si j’ai fini le vendredi à midi, bah très bien ». Cela n’arrive jamais. S’il me reste des pages à faire, je travaille le samedi. J’essaye de me garder de plus en plus les week-ends pour avoir un peu de repos. Avant je dessinais tous les jours mais en fait, on s’épuise énormément.
Valentin Paquot : C’est pareil pour toi, Shonen ?
Shonen : À peu près. J’essaie surtout de maintenir un rythme d’environ 30 pages par mois. Je me suis imposé un style très détaillé qui demande beaucoup de travail.
Valentin Paquot : Tu le regrettes un peu aujourd’hui ?
Shonen : Un peu. C’est aussi parce que c’est différent des styles que je fais habituellement. Mais c’est quelque chose qu’à la base je voulais tenter.
Valentin Paquot : Et toi, Julien ? En tant que scénariste, on imagine que l’écriture est un peu plus rapide en nombre de pages que tu peux écrire par jour. Tu attends les versions dessinées et finalisées par Shonen ? Est-ce que tu travailles au chapitre et vous faites un ping-pong ou est ce que tu as déjà écrit le tome d’un seul coup et tu envoies tout ?
Julien Blondel : C’est vrai que l’on n’a pas la même durée pour le même volume de travail, évidemment. Selon les projets, il y a 2 configurations, que cela soit en BD ou en manga, et spécifiquement en manga. Tu as des scénaristes qui vont écrire un album très franco-belge et proposer un découpage de l’album en cases avec des propositions de cadrage qui va être assez rapide pour ensuite donner toute la matière au dessinateur, pour le laisser faire les pages. Et quand tu fais ça, tu travailles pendant un mois, 2 mois et ensuite l’album se fait sans toi. Et moi je trouve ça important de rester au contact, disponible et de travailler en parallèle. Déjà parce que c’est un métier qui est solitaire et qu’en travaillant au minimum à 2, on peut avoir des échanges, s’envoyer des messages ou se voir selon le caractère ou le rythme que tu as.

Sur Dark Souls, par exemple, je fais les chapitres un par un. J’ai un séquencier à l’origine qui est calé avec le découpage en chapitres et à la page. C’est page 4 : ils sortent du château. Page 5 : on finit sur ça. C’est vraiment une espèce de squelette et ensuite, je fais une proposition de découpage par chapitre où là je vais un peu plus loin dans les descriptions. J’ai envie d’aller presque jusqu’au storyboard, sauf que je ne le dessine pas. Par exemple, case 1, je verrais bien un bandeau en contre-plongée avec le personnage à gauche. C’est une façon de dire à Shonen : « moi je vois ça comme ça, comment tu le vois, toi ? Si ça te parle, pars là-dessus. Si tu as une autre idée, tu réadaptes ».
Je pense que l’on doit fournir une base de narration pour accélérer le travail ou partager une vision. On fait les chapitres en parallèle parce qu’on avait des rythmes de travail ou des façons de travailler différents. Shonen s’organise tout seul comme un atelier avec des assistants alors qu’il est seul. Il a une façon de travailler qui est extrêmement particulière donc j’essaie de rester au contact pour travailler en parallèle, être disponible quand il a une question ou un besoin.
La charnière sur ce projet, c’est le storyboard. On s’envoie un storyboard et on rebondit dessus. La narration, les cadrages et l’emplacement même des bulles sont ainsi calés. Cela permet à Shonen de s’organiser librement sur la façon dont il veut attaquer le dessin, les décors, les personnages…
Valentin Paquot : Tu dis que Shonen est un homme-orchestre à lui tout seul. Shonen, tu dessines d’abord le personnage principal, ensuite les secondaires et après les décors ?
Shonen : En fait, je fais un peu le premier passage du mangaka et ensuite, je fais les passages des assistants : le décor et les détails. Et si j’ai encore le temps, généralement, je refais un passage pour finir les détails qui sont plutôt, on va dire, facultatifs pour enrichir les planches qui sont déjà bien denses. Ma méthode est assez particulière et il y a forcément au moins 2 passages. Je dirais que c’est une façon pour moi de sortir un peu de la routine car j’ai un peu de mal à rester 10 heures sur la même planche. Cela lasse et donc cela permet de changer les idées.
Une journée type d’un mangaka ou d’un scénariste français
Valentin Paquot : Du coup, on va rentrer dans le détail de votre travail justement. Racontez-nous vos journées ou semaines types, sans aller jusqu’à la marque de céréales que vous mangez le matin…pour voir comment on crée un manga à la française. Quelles sont les étapes ?
Yoann Vornière : Pour moi, c’est très rythmé. Enfin, moi, je ne mets pas de réveil déjà le matin : c’est un petit plaisir. Je commence directement le travail : je me lève, je m’assois et je dessine jusqu’à midi où je fais une pause tranquille. J’essaie de me caler sur 2 pages par jour. Depuis les tomes 4 et 5 de Silence, j’ai un assistant donc si je ne réussis pas à faire ces 2 pages par jour, mon assistant a du travail. J’essaye au maximum de finir quand même, ce qui me fait terminer la journée à 21h00 quand c’est cool et parfois à 3h du matin quand c’est plus dur. Si je me couche alors à 3h, le lendemain, je me lève plus tard et cela décale tout le reste de la semaine. C’est pour cela que ma journée est rythmée sur la nécessité de faire 2 pages par jour. Cela me permet aussi de réfléchir à la quantité d’énergie nécessaire pour chaque page, sachant que moi contrairement à Shonen, je suis un dessinateur peut-être un peu moins méticuleux.
Pour moi, ce qui est important, c’est vraiment la narration. Je sais que si la narration est propre, je n’ai pas besoin de passer trop de temps sur le dessin. Je ne suis pas illustrateur mais auteur de BD où ce qui est important est ce que je raconte. Avec ce parti pris, je m’évite aussi de souffrir et de passer plusieurs jours sur la même case ou la même planche. Cela me permet d’avancer de manière très régulière. Et peu importe ce que j’ai à dessiner, il faut qu’à la fin de la journée les 2 pages soient terminées.
Valentin Paquot : Quand tu te lèves, quand tu vas attaquer ces 2 pages, sais-tu déjà l’histoire ou tu n’as pas encore fait le travail de de séquençage ?
Yoann Vornière : Oui en gros, moi, quand j’écris, je n’écris pas en texte mais en storyboard. J’ai un mois on va dire où je ne travaille que sur le storyboard de tout le tome. Quand j’attaque les planches, je sais donc où je vais. Cela m’arrive de reprendre la composition d’une planche en fonction de l’inspiration du moment. En effet, quand on storyboard en janvier et qu’on attaque en mars ou en juin les planches, forcément, les envies sont différentes et on a plus de recul. Le découpage peut changer mais je sais ce qui doit être raconté dans la page.
Valentin Paquot : Et toi, Shonen ? Tu as parlé de ta dichotomie, de faire les personnages principaux puis le reste…
Shonen : Forcément dans ce genre d’organisation, je ne peux pas me donner pour objectif de faire 2 ou 3 planches dans la journée parce qu’étant donné que je fais plusieurs passages, au premier passage, aucune planche n’est terminée forcément. En fait, tout arrive plutôt dans les 2 ou 3 dernières semaines du mois. Je n’ai pas vraiment d’heures. Je sais juste que le matin je vais au Starbucks : j’ai toujours eu du mal à rester chez moi, l’antre de la tentation.
Valentin Paquot : Je sais qu’il y a des mangaka au Japon qui, quand ils sont un peu trop en retard, leur éditeur loue une chambre et les enferme à l’intérieur. Dans le cas de Gō Tanabe, il n’y a pas de lit.
Shonen : J’ai déjà demandé à mon éditeur si on pouvait me laisser une table et une chaise dans leurs locaux mais ils ne veulent pas. A la base, je cherchais juste une ambiance et pour d’autres raisons je préférais travailler dehors. Et depuis le Covid, j’ai commencé à beaucoup plus m’adapter au travail à la maison.
Valentin Paquot : On en revient un peu à cette solitude quand même, non ?
Yoann Vornière : J’avais juste une question à poser à Shonen : est-ce que tu travailles le week-end ?
Shonen : Oui…
Yoann Vornière : Tu bosses tous les jours, tu n’as pas de jour de repos ?
Shonen : En fait, cela fait 7 ans que je n’ai pas pris de vacances. Moi, personnellement, cela ne me dérange pas plus que ça : je fais quelque chose que j’aime bien.
Yoann Vornière : J’adore les vacances et j’en prends pour ma part. Et par rapport à la question de la solitude, je fais beaucoup de lives sur Twitch. Cela permet de rompre la solitude et je ne m’impose pas de règles. Quand je sens qu’il faut que je fasse un live, j’en fais un. Cela me permet d’être plus concentré. Il n’y a pas de distraction, je suis sur mon live donc je réponds aux gens tout en travaillant sur mes planches. C’est moins rapide mais j’avance de manière plus régulière.
Valentin Paquot : Avant de revenir sur le numérique, Julien, c’est quoi ta journée ou ta semaine type de scénariste ?
Julien Blondel : Moi, ça a beaucoup évolué. Au tout début, j’ai commencé à écrire en indépendant pour des magazines et des éditeurs, où à l’époque j’étais DJ la nuit. J’écrivais la nuit et je me réveillais à midi. Le rédacteur en chef m’appelait pour me réveiller et me disait « est-ce que tu es prêt ? Je te laisse 1 heure, tu te fais un café et dans 1h, je te rappelle pour te passer les commandes de texte pour la journée ou pour demain ». Cela a tenu 5-8 ans et petit à petit, tu commences à changer de rythme.
Et au bout de 30 ans d’écriture, je me lève maintenant entre 4 et 5 h du matin. C’est devenu mon rythme et je sais qu’à 10 h, 10h30, 11 h du matin, j’ai déjà fait presque une journée de travail. Tout ce qui demande de la concentration, le fait de pas avoir de bruit, pas d’appel ou de mail, c’est le matin. Et par exemple, pour l’écriture de dialogue qui demande une espèce de discussion avec soi-même, c’est le matin.
L’après-midi, c’est soit que j’ai besoin de travailler parce qu’on est en rush sur certains trucs. J’envoie des mails. Je rebondis sur les storyboards : j’ouvre Photoshop et je fais de la maquette parce que sur les BD, typiquement, je fais le lettrage et j’écris les dialogues dans les bulles que je place… L’après-midi, c’est un travail beaucoup plus mécanique. En ce moment, je dirais que je suis à mi-temps. Le matin, j’écris et l’après-midi, je suis dehors à la ferme et fais des trucs plutôt physiques comme planter des légumes et réparer des trucs. J’ai vraiment 2 journées bien distinctes.
Valentin Paquot : OK, c’est super chouette. Est-ce qu’on peut acheter les produits de ta ferme ou pas encore ?
Julien Blondel : Bientôt. Ma compagne qui est là est apicultrice et moi je passe au maraîchage. On commence à avoir du très bon miel et l’idée c’est aussi de faire venir les gens à la ferme pour avoir des activités avec eux, ouvrir une ruche, planter des légumes… Je trouve que c’est assez complémentaire.
Écrire ou dessiner sont des métiers solitaires. Je pense que l’on sous-estime beaucoup la volonté et le caractère qu’il faut. Il y a des gens à qui la solitude ne convient pas et ce n’est pas faute de talent ou d’envie… De très bons dessinateurs qui font de choses merveilleuses en BD découvrent après 1 an, 2 ans voire 3 ans que cette astreinte, cette dynamique de travail ne leur va pas, qu’il leur manque quelque chose. Ce manque d’interaction est une discipline qu’ils ne peuvent pas s’imposer sur le long terme. Il faut pouvoir supporter cette solitude et s’imposer cette discipline, cette auto organisation de travail.
Des ateliers d’artistes et des outils bien pratiques
Yoann Vornière : Dans toutes les grandes villes de France, contrairement au Japon, il existe des ateliers d’artistes que je conseille pour ceux qui ont un peu plus de mal avec la solitude. Dans ces ateliers, il y a plusieurs styles d’artistes, pas que la BD mais aussi les jeux vidéo, et cela peut être aussi très stimulant d’avoir un entourage qui travaille sur d’autres trucs, même sur de la BD mais d’une manière différente.
Valentin Paquot : Cela permet de partager un loyer aussi, ce qui est assez cool parce qu’être mangaka ce n’est pas être milliardaire. Au Japon, il y a 2-3 exemples de mangaka qui ont vendu des centaines de millions d’exemplaires mais cela reste exceptionnel. Est-ce qu’on parler d’outils ? Julien, tu as dit que tu écris sur ordinateur. Est-ce que c’est un traitement de texte basique ? Est-ce qu’il y a des outils pour avoir des annotations, pour garder un arbre généalogique en tête ? Est-ce que tu as un dictionnaire de synonymes ?
Julien Blondel : C’est vrai qu’il y a des outils qu’on avait pas il y a 20 ou 30 ans. C’est pareil pour les écoles, pour la formation à nos métiers, il n’y avait avant pas d’écoles spécifiques. Il y en a avait un peu en BD en Belgique, ensuite à Angoulême. C’est très récent d’avoir des écoles avec des formations, des logiciels et des outils dédiés à nos métiers. Et en scénario, à part ce qui était fait pour le cinéma et l’audiovisuel, pour les final drafts il n’y avait rien de spécifique et pas de logiciels de script.
Depuis 4-5-6 ans, la nouvelle génération dispose d’outils de création collaborative ou de création en ligne avec des mind maps, des post-it, des Trello pour s’organiser. Il y a énormément d’outils en ligne facilement accessibles, hyper ergonomiques pour essayer de s’y retrouver avec des arborescences entre les personnages… Pour ma part, je fonctionne à l’ancienne, sur Word uniquement.
J’écris les textes et après, je fais des notes et je crobarde/croque des petits storyboards pour voir si la séquence fonctionne sur un carnet avec un feutre noir. Apprendre à utiliser un nouveau logiciel formate aussi ta façon de travailler. Pour les gros univers, ce n’est pas le même travail. Par exemple, quand tu travailles sur un jeu de rôle, où tu dois développer un univers entier où il faut un sommaire, des chapitres, de l’indexation, tu peux utiliser des outils différents. Mais pour écrire des dialogues et décrire des cases, un crayon et un carnet suffisent avec ensuite un traitement de texte basique.

Valentin Paquot : Shonen, tu travailles en numérique ?
Shonen : J’utilise le numérique uniquement pour les illustrations en couleurs et pour le tramage. J’utilise le logiciel Clip Studio. Autrement pour les planches, je suis en traditionnel pur.
Yoann Vornière : Moi je travaille sur iPad et Clip Studio aussi. Maintenant, je suis par contre en tout numérique. Il n’y a plus que le storyboard que je fais en traditionnel. Un stylo bille dans le carnet, c’est le moment le plus amusant. On retourne dans son enfance à dessiner dans les marges de son carnet. Le passage au numérique permet d’essayer de gagner du temps mais ce n’est pas tout le temps plus rapide. C’est même parfois plus long parce qu’on peut zoomer et observer des détails qui ne se verront pas à l’impression.
Des conseils pour se lancer et bien négocier son contrat d’édition
Valentin Paquot : Shonen, tu avais évoqué une histoire qui ne s’était pas forcément super bien passée, on ne va pas en reparler mais est-ce que vous avez des conseils à donner ? Quels éléments faut-il faire attention peut-être d’un point de vue contractuel ou de l’engagement ?
Julien Blondel : Je laisserais mes camarades parler du dessin. Quand on se lance dans un projet quel qu’il soit, tu parlais des contrats par exemple, il est important de bien mesurer le temps que cela va prendre et d’être sûr de pouvoir consacrer ce temps au projet pour faire quelque chose de professionnel. Et même quand on développe un projet amateur par plaisir avec d’autres collaborateurs, il y a aussi un engagement qu’on se fait réciproquement : je m’engage à faire l’histoire, toi le dessin par exemple. Si ton dessinateur te dit qu’il est disponible dimanche après-midi ou lundi matin, il faut qu’il ait avant le texte dont il a besoin. Dans une collaboration, il faut respecter ses engagements.
Par rapport aux éditeurs, quand on arrive sur un contrat, déjà bravo car cela veut dire qu’il y a un projet qui va exister de façon professionnelle et ça, c’est beau, peu importe la qualité finale. Les meilleurs romans ce sont ceux qu’on a fini et qui sont imprimés. Pour les mangas, c’est pareil. Le prochain sera encore meilleur donc il faut y aller et ne pas hésiter à se lancer. Cela sera difficile et long. Ça va être pénible et il y aura plein de moments de doute mais il faut vraiment s’accrocher.
La discussion du contrat donne une bonne idée de la collaboration que sera le projet avec l’éditeur. Il faut savoir lire le contrat. Il y a énormément d’auteurs qui ne lisent pas bien leur contrat et qui ne regardent juste que le chiffre et la date. Et entre les deux, il y a plein de choses qui peuvent un peu changer ta vie, si cela se passe bien ou mal.
Il faut se faire accompagner et demander conseil à des auteurs sur Internet via leurs réseaux sociaux en leur disant qu’on est prêt à signer un projet de BD ou de mangas et qu’on a un contrat mais que l’on ne sait pas trop comment s’y prendre. Il faut demander des conseils à des gens qui l’ont fait. Que cela soit pour le dessin ou l’histoire, c’est la même chose pour les contrats. Il y a des gens qui ont déjà fait ce métier et qui sont prêts à accompagner et à souhaiter bonne chance.
Yoann Vornière : Par rapport aux contrats, le SNAC [NDLR : Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs] a publié Le Contrat BD commenté (disponible en PDF) qui décortique tous les éléments d’un contrat. La première chose à faire quand on reçoit le contrat, c’est de lire la brochure du SNAC et de voir s’il y a des choses à négocier ou des éléments qui paraissent pas terribles. Il ne faut pas avoir peur de prendre du temps à négocier son contrat. Lorsque c’est le premier contrat, on a envie de le signer tout de suite mais on ne sera jamais dans de meilleures conditions qu’avec un bon contrat.
Et le deuxième conseil, c’est d’avoir un dessin qu’on est sûr de pouvoir assumer sur le long terme. Un dessin ça se modifie, ça se réfléchit. Il ne faut pas se laisser déborder par son dessin et dire : « Ah moi je dessine comme ça et seulement comme ça ». Un projet prend plusieurs années et il faut être capable de modifier son dessin pour pouvoir tenir le rythme et la durée, pour toujours s’amuser, sans s’épuiser et s’ennuyer.
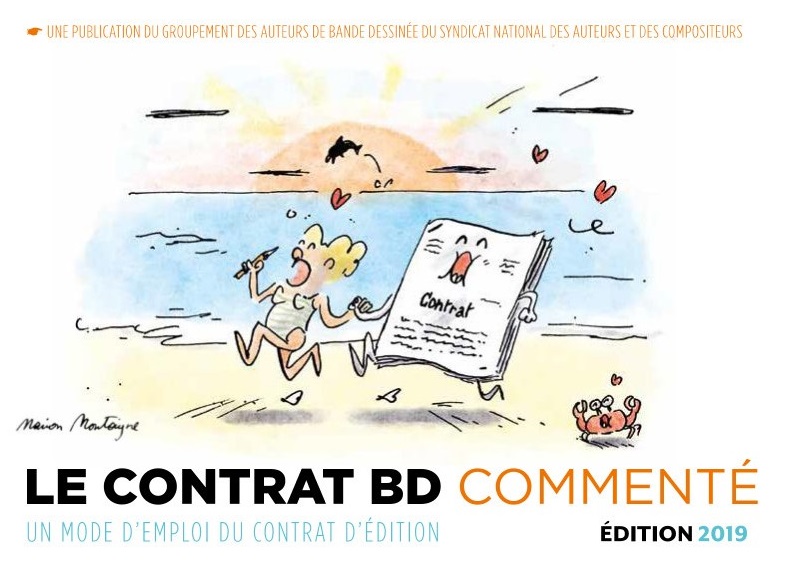
Julien Blondel : Je rebondis juste sur le SNAC BD que tu as cité. Je fais partie de l’équipe qui a monté le syndicat et je suis ravi de voir qu’il est utile et qu’il aide dans le milieu les auteurs. Ce n’est pas une discussion sur les contrats mais on a souvent l’impression qu’un contrat d’édition pour un auteur, c’est cool. « Tiens, voilà de l’argent, tu vas travailler pour moi » : la relation avec un éditeur, ce n’est pas ça. Le contrat d’édition, c’est l’inverse. C’est « je suis auteur, je fais faire un livre, est-ce que tu veux avoir le droit de l’éditer et de l’imprimer ? Je te donne par ce contrat le droit de le faire et en échange, tu vas me donner de l’argent, un pourcentage… et tu vas tenir tes engagements sur l’impression du livre». Les auteurs ne travaillent pas pour les éditeurs. Les auteurs travaillent pour eux : ils font une œuvre et l’éditeur demande le droit d’en faire un livre et de le distribuer. Ne pas l’oublier, cela change le rapport. Dans un contrat d’édition, c’est l’éditeur qui te demande le droit de faire ton livre et ça, c’est cool.
Valentin Paquot : Vous avez tous des parcours différents et il n’y a pas une porte d’entrée unique dans le monde de l’édition. Shonen, tu n’es pas rentré de la même manière aux Humanoïdes que chez Ki-Oon où c’était par un concours. Est-ce que tu peux nous raconter ces différentes approches ? Comment est-ce qu’on présente un projet ? Comment est-ce qu’on rentre dans une maison d’édition ?
Shonen : Je dirais que pour les Humanoïdes, c’était plus circonstanciel. J’étais à Japan Expo sur un stand associatif d’illustrateurs où je vendais des posters et je n’étais pas venu avec un dossier. Le directeur de collection de l’époque a remarqué mon travail et m’avait demandé si je voulais faire des mangas. A l’époque, je ne savais pas encore.
Pour Ki-Oon, c’était beaucoup plus carré je dirais. Même s’il y a eu le concours, je suis quand même venu avec un dossier en fait. Et pour le concours, on a discuté, mais après je pense qu’il y a quand même eu une forme de biais aussi. Parce que en discutant avec Ahmed Agne [NDLR : directeur éditorial à Ki-Oon], il m’avait dit qu’il m’avait déjà remarqué à l’époque des Humanoïdes et qu’il m’ attendait. À Angoulême [NDLR : au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême], en 2007, ils avaient un stand et c’est là-bas qu’ils avaient remarqué ce que je faisais. Ils m’ont donné la possibilité de travailler sur une œuvre personnelle.
Valentin Paquot : Yoann, comment est-ce que tu es rentré chez Kana ?
Yoann Vornière : Pour Kana, c’est tout simple : j’ai envoyé un dossier éditorial à tous les éditeurs qui faisaient à ma connaissance de la création originale manga. Et j’ai choisi parmi les éditeurs intéressés qui me l’ont fait savoir.
Valentin Paquot : C’est quoi un dossier de projet ? C’est le synopsis X pages encrées, une couverture en couleur ?
Yoann Vornière : En fait, cela peut prendre plusieurs formes. Il faut juste se dire que c’est sur ce dossier que l’on va être jugé. Il faut donc se mettre à la place de l’éditeur et se dire « Ok, je me projette tout de suite dans le projet et j’ai envie de le voir en librairie et que cela soit ma maison d’édition qui le défende ». Il faut donc que le dossier de projet soit digeste. Certains ont tendance à dire qu’ils ont fait tout le storyboard. Quand tu es éditeur, tu as aussi envie de participer au projet pour pouvoir le défendre. Quand tu reçois un PDF de 180 pages, tu te dis que tu ne vas pas le lire tout de suite.
Le projet doit être digeste et il ne faut pas forcément qu’il soit parfait. Par exemple, dans le dossier que j’avais envoyé, le scénario n’était pas calé et les planches du dossier ne sont pas dans les tomes mais je savais que c’était une bonne vitrine pour que l’éditeur se fasse une idée du projet et ce à quoi il allait ressembler. Je savais qu’il allait y avoir de l’action, des monstres, des scènes de discussion en langue des signes. Il fallait montrer tout ça avec les planches dans le dossier.

La conférence se termine par une question du public : Avez-vous suivi une formation ou êtes-vous autodidacte et avez-vous appris en copiant par exemple les œuvres que vous aimez et en développant vos projets personnels ?
Yoann Vornière : J’ai eu la chance de faire mon stage de 3ème dans un atelier à Toulouse où il y avait une petite dizaine d’auteurs de BD dont Tony Valente qui fait Radiant. À l’époque, il travaillait sur sa série Hana Attori et nos inspirations étaient assez proches : nous étions tous les deux attirés par le Japon et le manga. J’ai donc pu lui poser quelques questions lors de mon stage. J’ai appris en autonomie sinon. À l’époque, il y avait beaucoup de forums. Aujourd’hui, il faut faire plus attention aux conseils parce que maintenant, il y a tout et n’importe quoi sur les réseaux sociaux. Internet regorge de conseils et il y a énormément de livres, notamment pour le scénario comme La Dramaturgie de Yves Lavandier.
Félicitations aux lecteurs et aux lectrices qui sont allés jusqu’au bout de la table ronde. Vous en savez dorénavant plus sur le manga à la française et on espère que cela vous aura donné envie de lire Silence, Dark Souls, Outlaw Players mais aussi l’offre de création originale de manga français qui ne cesse de grandir ! Divers conseils ont été donnés : puissent-ils vous aider à vous lancer…
Le festival Cultissime n’a pas encore livré tous ses secrets… Retrouvez prochainement la retranscription de la rencontre avec les auteurs de Kana Classics pour le lancement du nouveau Capitaine Flam avec les dessinateurs Alexis Tallone et Jérôme Alquié (Capitaine Albator – Mémoire de l’Arcadia et Saint Seiya Time Odyssey).


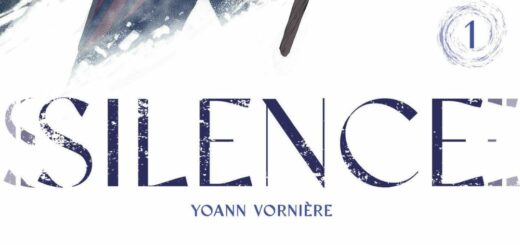
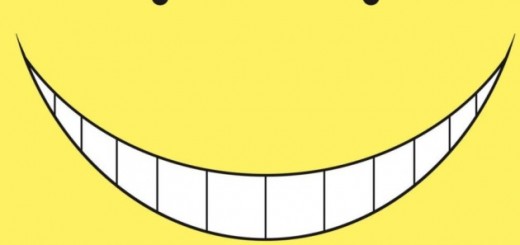








Merci pour ce passionnant entretien ! Beaucoup d’infos intéressantes.
NB. « La dramaturgie » est une bible. Mais il y a encore mieux, par Yves Lavandier : « Construire un récit ».