Vivre à Tatekawa – Entretien avec la réalisatrice Yôko YAMAMOTO
De 2012 à 2019, une caméra attentive a suivi la vie de Gunji et Ma-chan, deux sans-abris résidant dans le parc de Tatekawa à Tokyo. Entre le travail de récolte de canettes, les confrontations avec la mairie de l’arrondissement et la vie au quotidien dans le parc, s’esquisse le profil de deux personnalités déterminées qui, dans les marges, font face avec courage aux difficultés quotidiennes. Journal du Japon a la chance d’avoir pu s’entretenir avec la réalisatrice de Vivre à Tatekawa, Yôko YAMAMOTO, pour en apprendre plus sur la situation au Japon et la création de ce documentaire plein d’humanité, dans le cadre de sa projection par Fenêtres sur le Japon le 14 novembre 2023 au Forum des images à Paris.
De la langue à la photographie
Après avoir été diplômée d’un master de linguistique, vous choisissez d’entrer dans l’école de photographie de Tokyo. Pourquoi avoir fait le choix de la photographie ? Était-ce en lien avec vos études de linguistique ?
Avant d’entrer en école de photographie au Japon, j’ai enseigné le japonais durant quatre ans en Corée.
Durant mon master de linguistique, pour écrire mon mémoire, je faisais des analyses linguistiques à partir d’enregistrements vidéo. Peut-être que cette méthode de travail m’a influencée, car, depuis cette période, j’ai pris conscience qu’à travers la caméra, on pouvait voir un monde différent du nôtre. J’ai commencé la photographie quand je suis entrée à l’université. À l’époque, je ne prenais que des photos.
Quand j’étais en Corée, même avant d’y aller, je souhaitais me diriger vers la photographie et entrer dans une école spécialisée. Mais j’ai mis mes désirs de côté et je suis devenue professeure de japonais car je voulais aussi aller à l’étranger. Je pensais ainsi passer au-delà de mon désir pour la photo, mais il a continué à grandir au fond de moi, et j’ai décidé de rentrer au Japon et d’intégrer l’école de photographie de Tokyo pour une formation d’un an.
En 2008, vous publiez, aux côtés d’autres photographes, dans le recueil Tôkyô Machi Kôba chez les éditeurs Raichôsha. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait ce projet et comment en êtes vous venue à y participer ?
C’est une sorte de projet de fin d’études. Nous devions choisir nous-même notre sujet à prendre en photo, prendre contact, etc. Une fois par semaine, j’allais donc prendre des photos et discuter avec les personnes que je rencontrais. Le livre contient nos différents travaux de fin d’études.
Ça a été pour moi un premier pas dans le monde du reportage photo, et j’ai trouvé ça très intéressant. J’ai pu rencontrer des gens que je ne voyais jamais normalement, et le processus de restitution progressive du monde par la photographie était très stimulant.
Sans-abris et travailleurs journaliers au Japon
Selon la description du film donné par Fenêtres sur le Japon, la rencontre avec l’un des deux hommes du film a été le déclencheur du documentaire “Vivre à Tatekawa”.
C’était une autre personne que les deux personnages principaux du film, Gunji et Ma-chan. Il vivait au même endroit qu’eux, mais à la fin de mon tournage, il n’y habitait plus.
Était-ce pour vous un premier contact avec les conditions de vie des sans-abris à Tokyo ?
Oui ça l’était. Pour être plus précis, j’ai appris qu’il y avait des personnes qui vivaient grâce à la récolte de canettes d’aluminium : tous les sans-abris au Japon ne sont pas dans une situation similaire à ceux du film.
Est-ce une situation connue au Japon ?
Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, moi je n’étais pas au courant. Je savais que des gens récoltaient des magazines ou des journaux, mais je ne savais pas du tout quel genre de métier c’était, ou combien il gagnait en une journée de travail par exemple. C’était un monde qui m’était quasiment inconnu.
Quelle était votre motivation au début du tournage ?
Au départ, je ne m’étais pas préparée à prendre des photos ou des vidéos. Bien qu’à cette période je cherchais à me plonger dans de nouveaux mondes et faire de nouvelles rencontres pour prendre des photos, quand j’ai rencontré cette personne, je n’ai pas tout de suite voulu le photographier.
Votre perception de leur travail a-t-elle évolué durant le tournage ?
La première fois que je l’ai rencontrée, cette personne est rentrée plus tôt que tout le monde. C’était lors d’un petit pot après avoir vu le documentaire Yama – Yararetara yarikaesu avec des personnes engagées pour la cause des travailleurs journaliers. Il a alors dit qu’il devait rentrer plus tôt car il avait du travail le lendemain, et est rentré seul alors qu’il était venu accompagné. Ça m’a pas mal 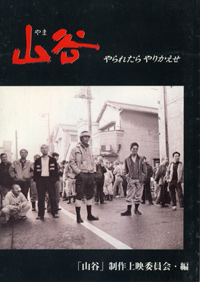 marqué. Lui-même était un activiste, et était très actif dans les manifestations. Pile avant cet évènement, j’étais en France où j’avais des connaissances parmi la CGT notamment, et je me suis demandée pourquoi, bien qu’il était engagé dans des manifestations contre le délogement du parc, il ne souhaitait pas toucher le RSA. Il m’a dit que c’était une promesse qu’il avait faite à sa mère. Plus tard, il a eu des problèmes de santé et a dû partir du parc de Tatekawa. Mais c’est lui, qui, lors de cette soirée, m’a invitée à venir voir où il vivait. J’y suis allée le lendemain.
marqué. Lui-même était un activiste, et était très actif dans les manifestations. Pile avant cet évènement, j’étais en France où j’avais des connaissances parmi la CGT notamment, et je me suis demandée pourquoi, bien qu’il était engagé dans des manifestations contre le délogement du parc, il ne souhaitait pas toucher le RSA. Il m’a dit que c’était une promesse qu’il avait faite à sa mère. Plus tard, il a eu des problèmes de santé et a dû partir du parc de Tatekawa. Mais c’est lui, qui, lors de cette soirée, m’a invitée à venir voir où il vivait. J’y suis allée le lendemain.
Cette rencontre a été très marquante pour moi, et je n’ai pas pensé directement à prendre des photos, même si je sentais au fond de moi qu’il y avait peut-être un sens.
Gunji et Ma-chan : JO, RSA et liberté
Vivre à Tatekawa se concentre sur la vie de 2 personnes, mais en regardant les arrières plans du documentaire, il est évident qu’ils ne sont pas les seuls habitants du parc. Avez-vous filmé le parcours d’autres personnes du parc de Tatekawa ? Pourquoi, au final, vous êtes-vous concentrée sur ces deux personnes ?
J’ai évidemment filmé la première personne que j’ai rencontrée. Mais au final, ceux que j’ai le plus filmés sont Gunji et Ma-chan, les deux protagonistes du film. J’aurais du mal à donner une raison claire. Il y avait des personnes à Tatekawa qui ne souhaitaient pas être filmés, mais ce n’est pas pour cette raison. En vérité, ils étaient toujours tous les deux là quand je venais, et toujours présents au devant de la scène lors des discussions avec la mairie. Donc au final, j’ai concentré mon film sur eux deux. Ils m’ont entraînée, moi et ma caméra, dès le départ.
Je ne le savais pas au début, mais leur relation remonte à quand ils vivaient ensemble dans un autre parc, duquel ils ont été délogés également. C’est après cela qu’ils sont allés tous les deux vivre dans le parc de Tatekawa. Je l’ai su au fur et à mesure que je les filmais. J’ai aussi filmé une autre personne qui est malheureusement décédée.
Ces deux-là possèdent une énergie particulière, ils vont toujours de l’avant. Ils prennent des initiatives pour plein de tâches différentes, et tirent les autres avec eux.
Au début du documentaire, nous assistons à l’expulsion du parc des sans-abris par la mairie de l’arrondissement à cause des rénovations réalisées dans le cadre des jeux olympiques de Tokyo. Savez-vous si ce genre de situation était répandue dans toute la ville de Tokyo ?
En 2012, dans les arrondissements de Sumida, de Kôtô et dans d’autres endroits de Tokyo, il y a eu beaucoup de rénovations, avec par exemple la construction de la Sky Tree. La rénovation du parc Tatekawa ne représente qu’une partie de la dynamique de l’époque, qui aujourd’hui est terminée. En 2013, les Jeux olympiques au Japon ont été annoncés, mais avant cela, le JOC (Japanese Olympic Comitee) inspectait toute la ville de Tokyo, et le parc de Tatekawa était sur leur chemin. Dans les environs, il y a eu beaucoup de rénovations de parcs, où des centaines de sans-abris vivaient. Les rénovations ont fait de ces parcs des parcs payants. Mon film se déroule dans l’arrondissement de Kôtô, mais il y a des choses similaires dans l’arrondissement de Shibuya par exemple.
Au début des travaux et lors du délogement des sans-abris, la mairie de Kôtô ne disait pas que c’était pour les jeux olympiques. Mais 2, 3 mois plus tard, après le délogement, les employés de la mairie portaient des pins du symbole des JO. Cela faisait donc bel et bien partie de la campagne. En plus, il y avait même des banderoles encourageant l’organisation des JO sur les bâtiments de la mairie. Tout cela juste après avoir chassé les sans-abris du parc. Si on regarde de manière chronologique c’est assez évident, enfin ça reste mon point de vue.
Quelles étaient les raisons évoquées par la mairie au départ ?
La rénovation du parc. Ils voulaient entièrement reconstruire l’endroit pour en faire un parcours de kayak, ou des terrains de foot en salle, tout ça payant bien sûr. C’était un endroit où beaucoup de sans-abris avaient élu domicile avec leur tentes, donc la mairie voulait “nettoyer” tout ça, et, en plus, y récolter de l’argent.
Savez-vous si leurs conditions de vie ont évolué depuis la fin du documentaire ?
De plus en plus d’habitants du parc de Tatekawa vieillissent. Vivre dans ces conditions facilite aussi les maladies, donc certains sont partis. De moins en moins de gens y vivent, et il n’y a pas de nouveaux venus. Le ramassage de canettes d’aluminium devient aussi de plus en plus dur pour eux : les sacs sont très lourds. Ça fait maintenant 10 ans que le parc a été barricadé suite aux travaux.
À plusieurs moments, notamment lors des passages à la mairie ou bien du dialogue sur le RSA, la responsabilité de l’État, ou bien de la municipalité face aux sans-abris est mise en question. Selon vous, quelle est la responsabilité de l’État face à la pauvreté au Japon ?
Du point de vue de la mairie, il est interdit de ramasser les canettes d’aluminium. On peut le voir dans le film, les personnes faisant ce travail sont traitées comme des voleurs. L’administration essaye de tout gérer : c’est le cas pour les parcs également qui étaient gratuits mais qui sont devenus payants. A l’origine, les canettes vides d’aluminium sont des déchets, non ? En mettant des cadres à des endroits où, avant, il y avait une liberté, ou bien en s’appropriant les choses qui n’appartiennent à personne, comme les canettes vides, l’administration sape peu à peu les moyens de vivre de ce type de travailleurs.
Concernant l’équivalent du RSA au Japon, plus de personnes en profitent qu’avant, mais il y a un “bizness de la pauvreté” (NDLR : en japonais hinkon bijinesu) qui supprime toute liberté. En vérité, on ne touche pas directement le RSA : l’argent va au foyer, on parle de doya pour ce type de foyer en japonais (NDLR : c’est un verlan du mot habituel pour parler de foyer, yado) où la personne habite, qui prélève ensuite directement le loyer. Les chambres y sont très étroites, la salle de bain et les toilettes sont communes, et on a même du mal à se nourrir. C’est totalement différent de la vie dans les parcs où on peut se débrouiller pour se faire à manger. L’administration contrôle tout.
Selon moi, l’administration ne veut pas laisser vivre les gens comme ils le souhaitent. Elle contrôle de plus en plus de parties de nos vies. Par exemple, il y a quelques années, même s’ il n’y avait pas de parkings prévus pour, beaucoup de vélos étaient abandonnés devant les gares. Si on voyait qu’il y en avait qui traînait là sans être utilisé pendant 1,2 ou 3 mois, on pouvait le prendre et l’utiliser. Mais maintenant, tous les vélos sont enregistrés avec un QR code donc la police sait directement quand il ne nous appartient pas à l’origine. En plus, les parkings à vélo devant les gares sont devenus payants, à 100 ou 200 yen l’heure : tout est pensé pour se faire de l’argent.
Les contrôles de l’administration sont devenus plus minutieux, et j’ai le sentiment que la liberté ou les actions des citoyens lambdas se retrouvent donc limitées : ils sont forcés d’entrer dans un cadre. C’est à mon avis, une des tendances au Japon. Les gens de l’administration ne peuvent pas tolérer les sans-abris qui vivent dans les parcs car ils n’entrent pas dans le cadre. Pour les faire entrer dans le cadre, ils les obligent à vivre pendant un an dans des foyers, au régime du “bizness de la pauvreté”, où ils perdent leur liberté et ne reçoivent en réalité presque pas d’argent.
Que pensez-vous de la responsabilité des sans-abris concernant leur situation ?
Au Japon, on parle beaucoup de “responsabilité individuelle”. Par exemple, quand nous distribuions des tracts devant la mairie, il y avait toujours quelqu’un pour nous dire que les sans-abris étaient à la rue car ils n’avaient pas bien géré leur vie, et que c’était donc de leur faute. Moi je ne crois pas que ce soit le cas.
Je pense que c’est très difficile de sortir des structures de la société, et à travers mon film, je n’aborde pas comment les deux protagonistes se sont retrouvés à vivre dans le parc de Tatekawa. Au contraire, je voulais montrer comment, depuis leur situation, ils faisaient face à l’avenir, sans évoquer une quelconque responsabilité. Dès ma première rencontre, j’ai senti qu’ils avaient tous les deux une attitude très positive et qu’ils vivaient sérieusement leur vie. Ils ont dû rencontrer beaucoup d’épreuves avec cette façon de vivre, le blocus du parc de Tatekawa étant l’une d’elles. Et pourtant, ils décident de vivre à leur manière : je souhaitais faire de cette attitude l’élément le plus important de mon histoire.
Le film montre également quelques scènes d’entraide au niveau local. Pouvez-vous nous en dire plus sur les actions des gens du quartier ?
Lors du délogement du parc, beaucoup de personnes se sont rassemblées. Des gens du quartier, mais aussi certains venus de plus loin pour nous aider. Comme je n’ai filmé que l’intérieur du parc à ce moment, on ne le voit pas dans le film, mais en dehors du parc cloisonné par la mairie, beaucoup de gens manifestaient de toute leur force et nous aidaient à garder contact avec l’extérieur.
Mais je pense qu’il n’y a pas de vrais échanges entre les personnes vivant dans le quartier et celles vivant dans le parc. Beaucoup de personnes viennent, souvent les mêmes, mais si on compare à la France, il y a sûrement moins de personnes qui vont déjeuner avec eux, leur apporter un repas car ils se feraient trop remarquer. Mais durant le délogement, même s’il n’y a pas eu énormément de monde non plus, des gens du quartier sont venus nous supporter.
“Je voulais qu’on voit cet endroit comme moi je l’avais vécu”
Le documentaire s’étend sur plusieurs saisons, il présente également des passages ou les deux personnages du film regardent le documentaire. Selon le site de Fenêtres sur le Japon, le projet a débuté en 2012 pour se terminer en 2021. Combien de temps exactement le tournage a-t-il duré ?
Le tournage a duré jusqu’en 2019. C’est l’année où j’ai tourné les scènes d’interview. Donc j’ai tourné de 2012 à 2019. J’ai beaucoup filmé en 2012, puis en 2013, mais à partir de 2014 je filmais de moins en moins. Je ne filmais pas énormément à chaque fois que j’y allais. En 2014, 2015 et 2016, bien que je me rendais souvent dans le parc, et participais aux activités et aux réunions organisées chaque semaine, je ne filmais que trois ou quatre fois par an. En 2017 et 2018 j’étais en France, et quand je suis retournée au Japon en 2019, j’avais fini en partie mon montage. Je leur ai donc montré ce que j’avais fait tout en les interviewant. Ces scènes sont les dernières que j’ai tournées.
Le documentaire nous livre des moments de vie parfois très intimes de ses sujets. Pouvez-vous nous décrire votre manière de tourner ?
Le plus compliqué était de les suivre quand ils récoltaient des canettes d’aluminium. Je devais filmer tout en montant à vélo, c’était vraiment pas facile.
J’essayais au mieux de ne pas les gêner : quand on pointe une caméra sur quelqu’un, c’est normal pour la personne d’être déstabilisée. Avec une caméra, j’avais l’impression que leur vraie attitude et leur vrai rythme changeaient. Je prêtais donc attention aux moments où ils s’habituaient et ne faisaient plus attention à la caméra, pour ainsi capturer leur vraie attitude. J’avais conscience de tout cela lors des tournages.
Aviez-vous une méthode précise pour capturer cette “vraie attitude” ?
Je ne filmais pas continuellement. Quand je me disais qu’aujourd’hui il allait se passer quelque chose, je prenais la caméra avec moi dans ma pochette, et la sortais rapidement pour filmer quand quelque chose m’intéressait, en prévenant avant bien sûr. A part à ces moments, je ne la sortais pas, mais je passais du temps avec eux. J’ai filmé beaucoup de choses différentes. J’ai évidemment demandé leur autorisation avant de les filmer, mais je pense qu’ils n’avaient peut-être pas conscience que ça allait réellement devenir, après un long montage, un film de 1h40.
Filmer de cette façon est devenu une sorte de routine pour moi. Même avant de commencer à filmer, Tatekawa était devenu un endroit important pour moi, je m’y sentais bien. Il y avait Gunji et Ma-chan, mais aussi d’autres personnes qui vivaient, et des activistes également. Le temps que j’ai passé avec eux, l’endroit, et les personnes représentent pour moi un moment précieux de quand j’étais au Japon. C’est avant tout cela, et je souhaitais mettre ce souvenir en forme.
Le film aurait pu leur déplaire, et ils auraient pu me dire de ne surtout pas le diffuser, ce que j’aurais compris. Ça aurait été un choc pour moi car je filmais tout ça depuis longtemps, mais je me préparais tout de même à ce que ça puisse arriver. Mais finalement, tout s’est bien déroulé.
Combien d’heures d’images avez-vous enregistrées ?
Alors là… Dans mon disque dur, les fichiers pesaient entre deux et trois terra, donc comme une heure de vidéo pèse 42 giga avec ma caméra…ça revient à plus de 50 heures. J’ai beaucoup filmé, mais tout ce que j’ai mis dans mon film ne représente qu’environ 70 pourcent des bons moments que j’ai passé avec eux. J’ai pris en vidéo plein d’autres moments, mais ils ne rentraient pas dans l’histoire de mon film. Par exemple, pendant la manifestation, j’ai filmé les manifestants jouer du Taiko (NDLR : grand tambour japonais) en protestation. On est aussi allé rendre visite une dernière fois à Monsieur Kimura, à qui appartiennent les chats que l’on voit dans le film, à l’hôpital avant qu’il ne décède. Ou encore nous sommes allés voir une personne atteinte d’Alzheimer qui autrefois vivait dans le parc. J’ai enregistré beaucoup de scènes, parfois très émouvantes.
En plus du tournage, vous-vous êtes également chargée du montage, du son, et de presque tous les autres aspects du film. Est-ce un choix pratique ou une volonté de contrôler de bout en bout votre documentaire ?
Avant tout, en tournant mon film, je ne savais pas s’il allait réellement aboutir ou non. On aurait très bien pu me dire de ne jamais le diffuser. En plus, je me suis beaucoup rendu au parc de Tatekawa qui est devenu un lieu important pour moi : s’il y avait, en plus de moi, un perchman qui enregistrait le son, l’ambiance de l’endroit aurait totalement changé. Pour le montage également, je voulais qu’on voit cet endroit comme moi je l’avais vécu, et transmettre toute la joie et les bons moments que j’y ai vécu. Je ne connaissais pas de monteur qui partageait cette expérience avec moi et qui aurait pu la transmettre. Je voulais tout faire seule en fait (rire).
Je n’avais pas de budget non plus. Normalement pour un film, un producteur ou autre réunit de l’argent et emploie quelqu’un pour le montage. Comme je n’avais rien de tout ça, j’ai fait seule. Du point de vue du budget, je n’avais pas le choix.
Il y a parfois dans le documentaire une différence très claire entre des plans fixes travaillés, et des plans en mouvement, que ce soit les passages à vélo ou pendant la manifestation au début du film. Ce découpage était-il conscient de votre part ou bien est-il le résultat des conditions de tournages ?
Quand tout le monde bougeait, je les suivais en filmant sans trépied. Ma caméra n’a pas d’autofocus donc je devais tout gérer par moi-même. Je faisais bien attention à ce que ce soit net en filmant, mais comme je bougeais moi aussi, c’était très difficile. En plus, l’écran de ma caméra est petit donc je ne pouvais pas bien voir si le focus était bon ou pas. C’est dans ces conditions que j’ai filmé.
Mais, durant les scènes d’interview filmées en 2019, j’ai installé un trépied, et j’ai bien été attentive à ce que l’image soit nette. Jusqu’à ces scènes, je n’avais filmé que des moments de la vie quotidienne : je ne leur posais pas de questions profondes sur leur vie, ou sur pourquoi ils ne demandaient pas le RSA par exemple. Mais je connaissais leur point de vue sur ces questions à travers nos discussions habituelles.
Vivre à Tatekawa : presque inédit au Japon
Est-ce que votre film a été diffusé au Japon ?
Au Japon, il a été diffusé une fois. Une fois par mois, une association appelée Video Act, dont Tokachi TSUCHIYA fait partie, se réunit pour regarder des films. Vivre à Tatekawa a été diffusé une fois dans ce cadre.
Je ne souhaite pas de sortie publique. J’ai aussi diffusé la version finale une fois dans le parc, et une autre fois dans une petite salle du quartier que j’ai louée pour l’occasion. Je ne pense pas essayer de le diffuser dans de grandes salles de cinéma. Gunji et Ma-chan vivent encore sur place, et j’ai mis dans mon film des images de gens du quartier ou bien d’employés de la mairie sans en demander l’autorisation. Je n’ai pas envie que mon film soit le point de départ d’un procès contre cet endroit, ou bien que les représailles de la mairie empirent la situation. Comme le lieu n’a pas bougé depuis, je ne veux pas mettre mon film en vente ou en salle.
J’ai tout de même candidaté pour le festival international du film documentaire de Yamagata, où en plus des diffusions lors du festival, les films sont également montrés dans quelques cinémas de Tokyo. La diffusion à Tokyo me gênait un peu et je pensais négocier avec les organisateurs. Au final mon film n’a pas été sélectionné donc je n’ai pas eu de soucis.
À l’inverse, il a été projeté en France à Lussas dans le cadre de la Route du doc – Japon.
Oui. La France est loin du Japon, et avec les sous-titres il est plus dur de localiser l’endroit car ce n’est pas écrit en japonais. Donc comme le Japon est loin et que ce n’est pas un endroit connu, je ne pense pas qu’une diffusion apporte des problèmes au parc. Parmi ceux qui l’ont vu en France, il y avait très peu de japonais. Les sessions de Video Act sont aussi en groupe restreint. Je n’ai pas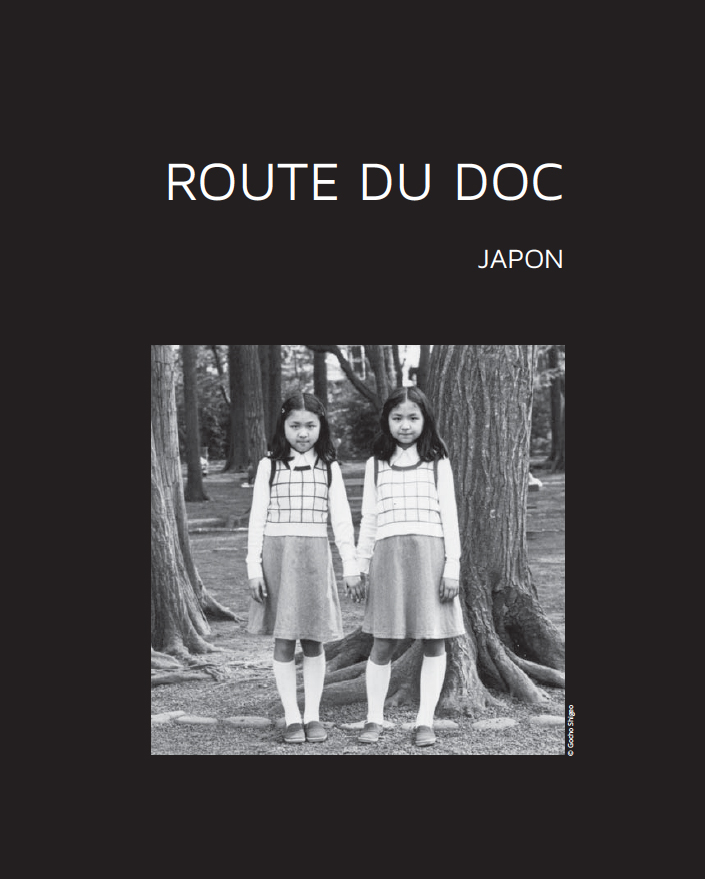 envie que tout le monde ait accès au film.
envie que tout le monde ait accès au film.
“Vivre à Tatekawa” sera projeté le 14 novembre au forum des images à Paris organisé par Fenêtres sur le Japon. Pouvez-vous nous expliquer comment est née cette collaboration ?
Je pense que ça remonte à ma candidature pour le festival international du film documentaire de Yamagata. Tamaki TSUCHIDA (programmateur du festival international du film documentaire de Yamagata) et Christophe Postic (codirecteur artistique des Etats généraux du film documentaire de Lussas) ont travaillé ensemble pour La Route du Doc : Japon en 2022. Dans sa recherche de film documentaire ayant pour thème le Japon, Christophe Postic a demandé une liste de film à Tamaki TSUCHIDA. Il était également en contact avec Fenêtres sur le Japon qui ont aussi envoyé une liste. Mon film était dans une des listes, et Christophe Postic l’a beaucoup aimé et l’a sélectionné pour la programmation de son festival. Je l’ai aussi montré à Dimitri Ianni (programmateur du festival Fenêtres sur le Japon) qui l’a beaucoup apprécié.
Ces retours positifs, alors que mon film n’avait pas été sélectionné pour d’autres festivals, ont été très importants. Sans ça, il n’aurait pas été projeté comme maintenant au Forum des images.
Comment vous a paru l’accueil du public français ?
Après la projection à Lussas, j’ai été très contente d’avoir pu parler du film avec les spectateurs. Ils me faisaient remarquer des aspects de mon film dont je n’avais pas conscience. La remarque qui m’a rendue la plus heureuse vient d’un monteur. Il m’a dit qu’on ressentait très bien l’énergie et la positivité de Gunji et Ma-chan à travers le film, notamment grâce aux scènes d’interview que j’ai tournées en dernier.
Faire ressortir cet aspect n’était pas mon objectif lorsque j’ai choisi d’ajouter ces scènes, elles m’ont surtout servi à faire le lien entre les différentes séquences du film, et à incorporer directement dans le film les paroles de Gunji et Ma-chan, que je n’ai pas pu capturer entièrement durant le tournage car je ne filmais pas tout le temps. Les passages d’interview servaient donc aussi bien de lien, qu’elles faisaient ressortir le cœur des scènes. Je connaissais déjà toutes les réponses aux questions que j’ai posées lors de mon interview. : c’était dans le but d’enregistrer et de transmettre ces précieuses paroles.
Le montage m’a pris pas mal de temps : après la fin du tournage en 2016, ça a duré 2,3 ans. Après avoir fini en 2019, j’ai filmé les scènes d’interview. Ce décalage entre la fin du tournage et les interviews n’étaient pas volontaire de ma part, mais au final je suis heureuse que ça aie pris du temps. En superposant les images de mon premier tournage et celles des interviews, on comprend le passage du temps et comment Gunji et Ma-chan ont vécu jusqu’à maintenant. C’est ce que le monteur m’a expliqué. C’est un effet que je n’avais pas anticipé, mais je pense qu’il a raison.
Merci beaucoup pour cette interview qui éclaire sur vos intentions et sur la création de ce beau documentaire. Nous vous souhaitons une bonne projection au forum des images le mardi 14 novembre à 20h30, et encourageons nos lecteurs curieux de s’y rendre.













