Littérature de Hokkaido : deux écrivains à découvrir
Journal du Japon vous invite à découvrir la littérature de Hokkaido, l’île du Nord du Japon à travers le regard de deux écrivains : le poète aïnou Iboshi HOKUTO (1901-192) et la romancière Akiko KAWASAKI (née en 1979).
Chant de l’étoile du nord : poèmes engagés et poignants d’un écrivain aïnou
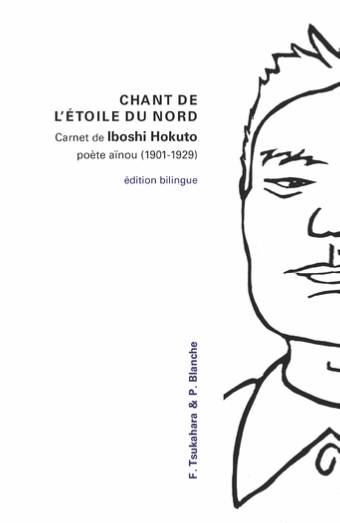 Les éditions des Lisières nous permettent de découvrir en édition bilingue les poèmes (essentiellement des tanka 5/7/5, 7/7 syllabes, mais aussi quelques haïkus 5/7/5 syllabes) du jeune poète aïnou mort à vingt-huit ans Iboshi Hokuto.
Les éditions des Lisières nous permettent de découvrir en édition bilingue les poèmes (essentiellement des tanka 5/7/5, 7/7 syllabes, mais aussi quelques haïkus 5/7/5 syllabes) du jeune poète aïnou mort à vingt-huit ans Iboshi Hokuto.
La situation du peuple aïnou au début du XXème siècle
Pour comprendre l’œuvre de Iboshi Hokuto, il faut connaître le contexte historique remarquablement rappelé dans l’introduction de Gérald Peloux :
« Le peuple aïnou a vécu, au faîte de son expansion géographique, sur un espace regroupant le nord du Japon (île de Hokkaïdo et nord de Honshû), la Russie (îles Kouriles et Sakhaline) et l’embouchure du fleuve Amour sur le continent asiatique. Ses origines restent toujours discutées et demeurent l’objet d’importants débats parmi les spécialistes. Ainsi la langue aïnoue est-elle un isolat : elle n’est liée à aucun autre idiome, ni au japonais, ni au chinois. À l’origine peuple de cueilleurs, chasseurs et pêcheurs dont la culture est entièrement basée sur l’oralité, les Aïnous ont rapidement joué un rôle d’intermédiaires entre les Japonais, les Chinois et les Russes. Avec la montée en puissance au cours du XVIIe siècle de l’empire des Tsars à travers la Sibérie, de l’affirmation de l’État-Nation du Japon à partir de 1868, la zone de peuplement des Aïnous s’est retrouvée au beau milieu des questions frontalières. L’île de Hokkaïdo, appelée autrefois Ezo, est ainsi annexée au Japon en 1869 et devient une terre de développement, autrement dit de colonisation.
Les premières mesures d’assimilation sont aussitôt prises par l’État japonais : en 1871, on impose aux Aïnous des noms japonais, on leur interdit de pratiquer leurs coutumes. En 1872, on leur interdit de facto la propriété privée et en 189 est votée la « loi de protection des anciens indigènes de Hokkaïdo » censée les protéger des effets pernicieux de la modernisation mais les minorisant davantage : les terres non encore distribuées aux colons japonais, les moins fertiles, sont données aux Aïnous pour les sédentariser – tout Japonais, et donc tout Aïnou, désormais officiellement sujet de l’empereur Meiji (1852-1912), ne peut qu’être agriculteur – tandis que des écoles spécialisées sont ouvertes pour japoniser leurs enfants. »
Une vie entre santé fragile, instabilité professionnelle et réflexions sur l’identité aïnoue
C’est dans ce contexte que naît en 1901 Iboshi Hokuto. Un père dans la pêche, une fratrie de huit enfants, et une entrée à l’école en 1908, école pour « shamo » (terme aïnou utilisé pour désigner l’ethnie japonaise). Pauvreté, discrimination, maladie, il termine ses études primaires en 1914 et n’ira pas plus loin. Il enchaîne différents métiers (pêche avec son père, vendeur ambulant de produits pharmaceutiques entre autres), s’intéresse à la question aïnoue lorsqu’il est au repos à cause de sa maladie. Il monte à la capitale début 1925 et s’implique activement dans le milieu associatif lié à la question aïnoue, rencontre des écrivains et des chercheurs, mais il ne trouve pas sa place et retourne en juillet 1926 à Hokkaïdo. Il est alors soutenu dans son écriture par la poétesse aïnou Batchelor Yaeko, va dans les écoles et les églises de l’île pour travailler à l’éducation et l’élévation spirituelle des Aïnous (tout en travaillant comme ouvrier), lance une revue littéraire, se passionne pour l’archéologie. Mais la tuberculose le rattrape et il meurt à peine âgé de vingt-huit ans début 1929. Ses poèmes (plusieurs centaines de tanka, quelques dizaines de haïkus) seront publiés dès 1930 et régulièrement depuis.
Simplicité et naturel pour une poésie du quotidien
Ce qui surprend à la lecture de ses poèmes, c’est la simplicité avec laquelle il évoque ses problèmes quotidiens, son travail, sa santé. Il ne cache pas ce qu’il pense sous des images bucoliques, il est « cash » et utilise des mots simples, crus, il ne tourne pas autour du pot.
Ainsi quand il vendait des médicaments par monts et par vaux :
J’suis un débutant
dans la vente de pommade
pour hémorroïdes
Tout doux, gentil toutou noir
ne m’aboie donc pas dessus !
Ou quand il manque d’argent :
Plus rien à manger
plus d’argent, mais à vrai dire
je m’en soucie peu
Ma nature nonchalante
prend ses aises en cette vie
Et quand il travaille durement à la pêcherie :
Vois comme je suis
devenu un vrai costaud
J’ai grossi un peu
Vas-y tâte mon poignet
et tu en auras la preuve
Avec le doux souvenir de son séjour à Tokyo :
Douceur de l’eau chaude
Les souvenirs s’en reviennent…
pâte de millet
ou de haricots sucrés
dans ce café de Tokyo
Et de doux poèmes autour des oiseaux :
Une jeune femme
cherche son enfant perdu
en criant coucou
coucou, encore coucou
et se transforme en oiseau !
Je voudrais quitter
le monde flottant des hommes
et pouvoir voler
comme ces mouettes blanches…
Partir au loin avec elles
Jusqu’à la maladie qui le ronge :
Maladie, souffrance,
on devrait s’y résigner
Mais parfois je pense
peut-être vaudrait-il mieux
s’éteindre pour en finir
Mais aussi une poésie engagée
Sa poésie et ses essais livrent une réflexion passionnante sur l’identité aïnoue. Il y critique la dépossession (déculturation) volontaire, mais affirme aussi avec force la nécessité d’une reprise en main par les Aïnous eux-mêmes de leur futur.
« Ceux-là qui sont forts ! »
ainsi s’appelaient les hommes
du peuple aïnou…
N’avez-vous pas un peu honte,
réveillez-vous compagnons !
Gérald Peloux précise : « On retrouve les éléments qui ont marqué tous les peuples minorisés et colonisés, dépendance à l’alcool mais ici surtout les misemono, ces attractions de fêtes foraines au cours desquelles le Japon, à l’instar d’autres pays, montre des êtres considérés comme anormaux mais aussi des peuples non conformes à la japonéité, donc bien sûr les Aïnous. »
Hokuto écrit ainsi :
Ah est-ce la faute
du vin de riz, est-ce à cause
de leur ignorance ?
À la foire sont exposés
au public des Aïnous
S’il condamne l’assimilation culturelle et « génétique », il ne condamne pas l’intégration dans l’empire en tant que citoyen/sujet, comme on peut le lire dans son ouvrage Kotan cité en introduction :
« Je ne veux pas être Aïnou – ce n’est pas ce que je veux dire. Je veux être un shamo – ce n’est pas non plus ce que je veux dire. Alors quoi ? Je parle d’un « esprit en quête d’égalité », d’un « coeur qui demande la paix ». Pour le dire plus précisément, je « désire vivre en tant que sujet japonais ».
Pour les Aïnous
en voie de disparition
puissent mes poèmes
continuer leur route et
interpeller ma nation
Un poète à découvrir dans un ouvrage très complet.
Plus d’informations sur le site de l’éditeur.
Des chevaux et du vent : chant d’amour à la nature, aux chevaux et à leurs éleveurs
Akiko Kawasaki est née à Hokkaido où elle travaille dans la ferme laitière familiale après un diplôme en économie et une année en Nouvelle-Zélande à apprendre les techniques d’élevage des moutons. Dans ce roman d’une puissance rare, elle nous raconte l’histoire d’une famille sur plusieurs générations, du Tohoku à Hokkaido. Une immersion au pays du vent, du froid, des chevaux puissants qui vivent avec les hommes dans une nature belle mais rude.
Sutezô est l’enfant d’une passion entre la fille d’un chef de village du Tohoku et un orphelin pauvre. Pour échapper à sa condition, à dix-huit ans, il décice de partir et c’est vers l’île d’Hokkaido qu’il se dirige avec une jument. On cherche des pionniers pour défricher ces terres au nord du Japon.
« Ce n’était pas par désir de fortune. Ce n’était pas par cupidité. Sutezô avait seulement le désir d’un morceau de terre qui n’appartiendrait à personne et qui lui suffirait pour vivre. Un endroit différent de celui où il avait grandi, où tout, le village, les petites rizières, les montagnes, appartenait à quelqu’un depuis des siècles. Un endroit où personne ne vivait encore et qu’il cultiverait de ses mains. Il lui suffisait d’y penser pour que les rêves se mettent à jaillir. »
Il laisse derrière lui sa mère qui n’a plus toute sa tête depuis qu’elle a dû manger le cheval (de son compagnon, animal qu’elle adorait) avec lequel elle s’est retrouvée enfermée dans une congère lorsqu’elle voulait échapper aux villageois. Alors enceinte, elle a lutté pour survivre dans cet espace glacé, connu la faim la plus douloureuse. Une faim qui s’est transformée en folie et lui a fait commettre cet acte qui la hantera pour toujours (tout comme la lecture de ce passage hallucinant du roman hantera longtemps le lecteur !).
C’est à Nemuro, une ville sur la côte pacifique, battue par des vents glacials, qu’il s’installe. Il y élève des chevaux solides, durs à la tâche, qui accompagnent les agriculteurs et les pêcheurs dans leurs activités quotidiennes. Et le lecteur découvre ces terres sauvages en même temps qu’il voit la petite-fille de Sutenzô, Kazuko, prendre la relève de son grand-père auprès des chevaux qu’elle chérit plus que tout.
Un quotidien simple, bien organisé, frugal mais harmonieux.
« Dans ces lointains, vivre n’est pas une chose aisée. Ils avaient défriché un champ à l’abri des vents de la mer, derrière la maison, où ils cultivaient de la patate douce et des légumes verts. Grâce au fumier de cheval bien mûr, ils poussaient bien, même sur sol sablonneux. À l’automne, on les stockait dans la resserre qu’il avait consruite à côté de la maison, sur une élévation de terre bien tassée, afin de passer l’hiver. On ne gaspillait rien de ce qui poussait tout seul sur le littoral non plus. Au printemps on récoltait les gléhnies, à la fin de l’été on cueillait les fruits mûrs des rosiers rugueux et des airelles rouges. C’était le travail des enfants, ainsi apprenaient-ils à travailler tout en y prenant plaisir. C’est ce que faisaient tous les enfants de la région, à l’époque. »
« Du printemps à l’automne, quand les jours duraient longtemps, les chevaux étaient parfois mis au pâturage avant d’entrer à l’écurie. Là, ils broutaient l’herbe fraîche avec un mouvement habile de leurs lèvres douces. Rien ne rendait Kazuko plus heureuse que cette vision des chevaux se remplissant paisiblement le ventre. Tout inexpérimentée qu’elle était encore, elle se sentait pleinement capable d’élever des chevaux et de leur donner ce dont ils avaient besoin à suffisance.
Une fois rassasiés, elle les appelait d’une voix forte « Poh poh poh poh … » Alors les chevaux relevaient la tête et accouraient vers elle. »
Mais la vie de la famille sera bouleversée et les générations suivantes ne connaîtront pas cette relation si intense avec les chevaux… Pourtant Hikari, la petite-fille de Kazuko, se rendra dans la ville de ses ancêtres et rencontrera sur l’île de Hanajima un cheval descendant de ceux de son arrière-arrière-grand-père.
C’est une déclaration d’amour aux chevaux, à ceux qu’on a voulu faire disparaître pendant l’ère Meiji parce que trop petits, au sang chaud, pas commodes par rapport aux chevaux occidentaux. Une ode au cheval trapu, aux jambes puissantes, aux yeux ardents, qui halent des filets à algues laminaires dans la mer, au cheval compagnon ou au cheval retourné à l’état sauvage.
Une déclaration d’amour à la nature puissante, âpre, inhospitalière mais belle, à la forêt profonde où le grand-duc vous explique que vous n’êtes qu’un petit être humain, à la prairie balayée par le vent, à la mer sur laquelle un bateau n’est qu’une coquille de noix. Humilité, respect, harmonie … Cela semble difficile voire impossible par les temps qui court, mais ce livre donne envie, force, espoir !
Un grand livre dont le souffle restera longtemps en vous ! Et une romancière dont on espère pouvoir découvrir d’autres ouvrages bientôt !
Plus d’informations sur le site de l’éditeur.








