Paroles de Trad’ : le récit d’un géant de la traduction, Thibaud Desbief
Retour sur les invisibles du manga avec une nouvelle interview de traducteur, et non des moindres ! Naoki URASAWA, Inio ASANO, Hiro MASHIMA, ces grands auteurs n’ont pas de secret pour Thibaud Desbief, géant de la traduction et adaptateur phare des éditions Kana. Ses 20 ans d’expertise et sa parfaite maîtrise de la langue française font de lui un traducteur hors pair et un des plus prisés du secteur. Malgré sa renommée et les grands projets qui lui sont confiés, il ne néglige pas sa vie personnelle pour autant. Père de famille attentif, il organise ses semaines de manière à pouvoir se consacrer à sa famille au Pays du Soleil-Levant… Et nous laisse même un peu de place pour répondre à nos questions !
Journal du Japon lui tend donc aujourd’hui le micro pour parler de son succès, de son point de vue sur l’évolution de son métier et sur les atouts d’un traducteur du futur !
Tombé dans la BD depuis tout petit
Journal du Japon : Bonjour et merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview au milieu de votre emploi du temps chargé. Vous êtes traducteur depuis plus d’une vingtaine d’années, votre nom est devenu incontournable dans le secteur, mais le nombre de nouveaux lecteurs augmentant toujours plus chaque année, pourriez-vous nous rappeler votre parcours jusqu’ici ?
Thibaud Desbief : Je suis un enfant des années 70, et j’ai commencé à lire de la bande dessinée très jeune grâce à mes grands frères qui étaient et sont encore aujourd’hui de grands lecteurs. J’ai hérité de toutes leurs BD, donc j’ai commencé par les classiques : Tintin, Spirou, etc., et à mon adolescence, je me suis intéressé à des genres différents, comme des comics américains entre autres. Vers la fin des années 80, Akira sortait au cinéma, et après être allé le voir, je suis tombé sur son manga en librairie. À l’époque, Glénat avait très bien fait les choses, la bande dessinée était très bien mise en valeur dans les rayons. J’ai tout de suite accroché, et je peux assurément dire que lire Akira aura constitué le début de ma fascination pour le manga. Comme beaucoup de personnes de ma génération, je me suis intéressé au manga à travers l’animation japonaise, mais pour ce qui est du format papier, le premier manga aura été Akira.
À la fin de mes années de lycée, les rares mangas qu’on pouvait lire en français étaient ceux de Glénat, Gunm et Akira notamment. La traduction en elle-même m’intéressait déjà, mais je n’avais jamais appris le japonais, et ça n’était rien de plus qu’une idée. J’ai donc finalement fait des études de comptabilité et de gestion pendant 3 ans, avant de comprendre que ça ne me plaisait pas forcément, et que je ne me voyais pas devenir commissaire aux comptes. Donc il m’a fallu chercher autre chose sur Marseille où je vivais. A ce moment-là, le cursus de japonais de l’Université de Provence était quasi inexistant, donc je suis parti aux langues Orientales de Paris où je suis resté pendant 3 ans. J’ai pas mal trainé la patte à la fac, mais j’ai eu une occasion de partir au Japon pendant l’été. Je suis allé là-bas dans l’idée de revenir à la prochaine rentrée en automne, ce qui n’aura pas été le cas car j’ai trouvé un travail directement sur place, une semaine après mon arrivée. Je suis resté un an et demi à Kamakura en tant que professeur de Français, avant de rentrer en France pour reprendre mes études.
Mais forcément, après avoir goûté une fois au Japon, il fallait que j’y retourne. J’ai repris mes études, j’ai passé un concours du Ministère de l’éducation japonais pour avoir une bourse d’étude qui m’a permis d’étudier un an à l’Université de Keio.
Entre temps, j’avais commencé ma collaboration avec Kana. Leur label avait été créé en 1996, ce qui faisait d’eux le troisième éditeur de manga avec Tonkam et Glénat. Ils cherchaient des stagiaires, des personnes qui connaissaient le milieu du manga, et c’est comme ça que j’ai pu modestement participer au lancement de l’aventure Kana avec Vincent Zouzoulkovsky et Misato Kakizaki-Raillard. Au début de cette collaboration, je n’avais pas encore le niveau pour faire de la traduction, alors j’ai commencé en faisant de la relecture et de la réécriture.
Lorsque je suis reparti au Japon, Yves Schlirf qui était directeur de Kana à l’époque, m’a proposé de prospecter sur place et de les guider pendant leurs voyages annuels. On s’est côtoyé pendant plus de 10 ans, on a beaucoup travaillé et j’ai participé à l’ensemble de leurs projets au Japon. J’étais au début du processus et j’avais donc la possibilité de postuler pour de nombreuses traductions de manga qui me plaisaient et je ne m’en suis pas privé ! (Rires) Le changement de direction de Kana a coïncidé avec mon retour en France : j’avais besoin de passer à autre chose, je me suis éloigné de l’édito de Kana pour me concentrer sur mon activité de traducteur.
Je suis resté au Japon jusqu’en 2011, donc presque 12 ans, avant de rentrer à Marseille pendant 5 ans.
Et aujourd’hui, cela fait plus de 4 ans que je suis revenu à Tokyo.
Que pouvez-vous nous dire sur l’évolution de votre métier aujourd’hui en termes de technique et de concurrence ?
L’avantage d’être un dinosaure, c’est qu’on a vu le monde évoluer. (Rires)
Ça a effectivement évolué, mais dans un bon sens. A partir des années 2000 il y a eu une vraie professionnalisation des acteurs de la chaîne de l’édition (traducteurs, graphistes, éditeurs, etc…). Il y a des traductions qui ont été faites entre 1995 et 2005, y compris les miennes, qui ne passeraient probablement plus aujourd’hui car on y porte beaucoup plus d’attention. Au sein de l’édition elle-même, cette évolution est vraiment palpable. Les mangas qui sortent aujourd’hui sont, à quelques exceptions près, irréprochables. Il y a vraiment des mangas magnifiques qui n’ont rien à envier aux autres secteurs de l’édition.
Concernant le point de vue technique de la traduction, je dirais que ce qui a changé c’est qu’à mon avis, plus aucun traducteur n’est capable de travailler sans internet. En 1995 internet n’était pas encore aussi popularisé et accessible que maintenant, les recherches se faisaient dans les ouvrages de référence, dans les bibliothèques. Il fallait vérifier, revérifier, ouvrir un livre, le refermer et passer à un autre. Tout ça prenait un temps considérable. Aujourd’hui le traducteur est chez lui avec internet et consulte ses dictionnaires et ses sites de référence sans bouger. Personnellement, je ne me vois plus travailler sans internet maintenant, c’est tellement pratique, efficace et rapide. On gagne énormément de temps grâce à ça.
Cette utilisation d’internet vous aide-t-elle à passer moins de temps qu’auparavant sur vos traductions ?
Je ne peux pas dire que je passe moins de temps sur une traduction aujourd’hui. C’est vrai que j’ai beaucoup plus de vocabulaire, je passe donc moins de temps à rechercher le sens d’un mot dans le dictionnaire, mais le vrai challenge du travail de traducteur se trouve dans la tournure de phrase. Trouver la bonne structure de phrase, le bon enchaînement entre les bulles… c’est ce polissage du texte qui prend le plus de temps. Là-dessus, le travail que l’on fait maintenant est le même qu’il y a 20 ans. Je pense, ou du moins j’espère, que mon expérience me permet d’être plus efficace sur ce point, mais le temps passé dessus reste à peu près inchangé.
Combien de temps mettez-vous pour traduire un volume ?
En moyenne, je bloque une semaine sur mon planning pour traduire un tome de manga shônen, Ça dépend bien sûr du manga : Hunter x Hunter prendra minimum deux semaines. Sa traduction est épuisante, la quantité de texte et d’information est lourde. En plus de ça, comme on a droit qu’à un tome tous les un an et demi à deux ans, il faut relire les tomes précédents pour se remettre en tête les évènements, ou replacer les personnages qui sont très, très nombreux… Mais ce genre de cas mis à part, mon rythme de traduction est d’une semaine.
Parlons d’avenir et de numérique
La menace de l’intelligence artificielle avec l’arrivée de logiciels de traduction automatique toujours plus performants plane sur votre métier. Que pensez-vous de cette technologie ? Vous sentez-vous réellement menacé par rapport à ça ?
C’est vrai qu’on le voit un peu tous les jours sur nos téléphones portables et PC : dès qu’on ouvre une page d’un site étranger, on nous propose une traduction en français, réalisée évidemment par une IA. La personne qui travaille dans la traduction et qui ne comprend pas qu’on la pousse gentiment vers la sortie, c’est qu’elle ne veut pas le voir. (Rires) Je pense que beaucoup se réfugient dans l’idée que cela reste de la traduction littérale et superficielle, et que pour la traduction dite littéraire, on aura toujours besoin d’un vrai traducteur.
Certes, le jour où les éditeurs prendront un manga en japonais, le passeront dans une machine et qu’ils obtiendront un ouvrage parfaitement traduit en français, ce n’est pas pour demain. Par contre, faire traduire des textes par une IA et transmettre ensuite aux traducteurs le texte grossièrement traduit pour qu’ils l’adaptent et le vérifient, ça, c’est pour bientôt.
C’est ce qui se fait déjà dans les secteurs techniques ou informatiques, la plupart des traducteurs utilisent déjà des systèmes, des logiciels de traduction automatique. On y échappera difficilement.
Beaucoup de « scantradeurs » aussi travaillent comme ça et on sait que le « progrès » arrive d’abord par les moyens illégaux. Crunchyroll est un bon exemple : à l’origine, il y a très longtemps, avant de proposer une offre parfaitement légale, Crunchyroll proposait des animés sous-titrés, dont beaucoup étaient traduits par des fans, sans licence. Et ça a tellement bien marché qu’ils se sont développés et sont aujourd’hui un des leaders du marché.
La menace existe aussi pour les éditeurs français : le jour où les éditeurs japonais n’auront plus besoin des Français de France pour avoir un texte clair et bien construit, tout ce qu’il leur faudra ce sera un réseau de distribution. Si jamais ça arrivait, les traducteurs, éditeurs et même graphistes, seraient très embêtés. Mais ça, je crois que tout le monde le sait depuis longtemps.
Les éditeurs français s’efforcent d’offrir aux lecteurs du simultrad pour de grosses séries. Cela signifie donc que les chapitres sont traduits et publiés en même temps qu’au Japon.
Vous vous êtes déjà lancé dans le simultrad avec Edens Zero chez Pika. Est-ce que vous souhaiteriez en faire plus régulièrement ?
Pour tout dire, j’ai déjà quatre simultrad en cours. Platinum End qui était mon premier est un mensuel, mais il est presque plus difficile à gérer que les hebdomadaires parce qu’il y a plus de pages et que le temps dont on dispose reste le même, voire plus court. Le deuxième c’est To Your Eternity de OIMA Yoshitoki. C’est un hebdomadaire mais l’autrice ralenti un peu la cadence donc ça me permet de souffler un peu. Quant aux deux derniers, il s’agit effectivement d’Edens Zero mais aussi de Fairy Tail : la quête de cent ans qui lui est un bimensuel. Tout ça demande une certaine organisation, mais je suis tout à fait partant pour le simultrad, c’est à chaque fois un challenge.
Il faut que ce soit le plus clair et exact possible, sinon on risque de passer totalement à côté de ce que l’auteur voulait dire mais il faudra assumer… (Rires)
Vous avez évoqué le scantrad, est-ce que vous auriez un message pour les lecteurs lisant des scantrads et ceux qui en font la traduction ?
Je commencerais par leur dire « Achetez des mangas ». (Rires)
Autant ceux qui les traduisent que ceux qui les lisent. Continuez à acheter des mangas sinon on va tous, eux y compris, être malheureux. Si personne n’en achète, il n’y aura plus personne pour en créer et on va finir par se retrouver avec les mêmes mangas d’il y a 40 ans parce qu’il n’y aura plus que ça à lire. Il faut soutenir la création, et le seul moyen pour ça, c’est d’acheter des mangas.
Je comprends très bien qu’avec la quantité de mangas qui sort aujourd’hui c’est impossible de tout acheter. Personne n’a les moyens d’acheter 150 nouveaux mangas par mois, mais on n’est pas obligé d’être boulimique, on peut sélectionner ses séries… Il y a aussi beaucoup (trop) de séries hyper longues.
Quand j’ai commencé les mangas, les séries les plus longues (à l’exception de Kochikame qui fait 200 tomes) c’étaient Hokuto no Ken avec 27 tomes et Dragon Ball avec 40 tomes, et on se disait déjà que c’était trop long. Maintenant One Piece ou Detective Conan font presque 100 tomes chacun, et si une série du Jump fait moins de 20 tomes on dit presque « Mais c’est trop nul ! Ça s’est arrêté trop tôt ! ». Mais quand on sait que 20 tomes représentent 4000 pages, une histoire sur 4000 pages, c’est déjà énorme à mon sens.
Après, je ne comprends pas vraiment la logique du scantrad aujourd’hui. J’entends souvent que ce sont des gens « passionnés », « bénévoles » qui font ça pour l’intérêt de la communauté, mais quelle est la finalité de traduire One Piece , par exemple ? Dans tous les cas, la suite va arriver puisque la licence est acquise par un éditeur. Pourquoi un traducteur de scantrad s’embête-t-il à traduire un titre qui sera traduit par des professionnels deux, trois mois après ? Si j’étais scantradeur, j’essayerais plutôt des titres que personne n’a jamais essayé de traduire et de partager quelque chose que j’aime et que le public français ne connaît pas encore.
En tant que traducteur, je ne vois pas quel challenge il y a à traduire des titres déjà publiés et populaires dans mon propre pays. Quand je faisais un fanzine sur le Japon avec mes amis, à Marseille, il y a très (très) longtemps, on écrivait des articles sur nos séries préférées, celles que peu de personnes connaissaient. Le but était de partager ce qu’on aimait et de faire découvrir autre chose.
Donc pour ça, la logique du scantradeur des années 2020 m’échappe un peu. Il y a énormément de mangas formidables qui sont et ne seront jamais traduits. C’est dommage qu’ils n’aillent pas dans cette voie-là.
Le manga numérique en France cherche petit à petit à se faire une place sur le marché, mais cela semble encore difficile alors que les Japonais semblent davantage lire sur leur smartphone. Comment interprétez-vous le retard du marché français à ce sujet ?
Je pense que c’est un peu similaire au magazine de prépublication. En France, on a fait des essais mais on s’est rendu compte qu’on n’avait pas les mêmes habitudes de lecture. A l’époque où les Jump ou Sunday Magazine se vendaient comme des petits pains au Japon, tout le monde s’est dit qu’il fallait faire ça aussi chez nous, mais on n’a jamais réussi à développer le système parce qu’on n’a pas la même manière de lire les mangas que les Japonais. Ils circulent beaucoup et longtemps de leur lieu d’habitation à leur lieu de travail. Et le réflexe qu’ils ont eu pendant longtemps c’était d’acheter un magazine au Kiosque, et le lire sur le trajet. Et ces habitudes de déplacements maison / travail n’ont pas changé, sauf que le média qu’ils utilisent a changé. Avant c’était un magazine papier, aujourd’hui c’est un smartphone. C’est comme ça qu’ils tuent le temps de trajet, et c’est cette habitude-là qui fait que le manga numérique au Japon est devenu un vrai marché et qu’il est aujourd’hui nettement plus développé.
Même si les magazines ne sont plus tirés qu’à 1 million d’exemplaires au lieu de 3, ils n’ont pas perdu 2 millions de lecteurs, ils les ont en partie récupérés en numérique.
Un deuxième facteur est sûrement lié au modèle économique. C’est-à-dire que, de nos jours, tous les éditeurs japonais ont leur propre plateforme de lecture : certains ont des plateformes fermées comme Shueisha avec Jump + et dans laquelle on retrouve tous leurs titres. Les titres de Jump ne sont disponibles que sur cette application, même Amazon Kindle ne peut pas les proposer. Mais c’est quelque chose qui n’est pas possible chez nous pour la simple raison que les titres du Jump sont éparpillés dans le catalogue de différents éditeurs français, qui lui-même regroupe des mangas de différents auteurs japonais. Et il est difficilement imaginable de voir Shueisha accepter de proposer ailleurs les offres actuellement sur Jump + au Japon.
Il y a aussi la question du prix à prendre en compte : au Japon, on peut lire des mangas gratuitement sur les sites légaux. Les offres promotionnelles sont très fréquentes, il y a un réel intérêt à lire à travers une application au Japon.
Il faut aussi comprendre que le Japon réfléchit à la vente de manga non pas comme la vente d’un objet, mais comme un contenu. Il ne vendra pas un manga la moitié de son prix parce qu’il est dématérialisé, le contenu reste le même. Ils vendent avant tout l’histoire. C’est ce qui fait aussi toute la différence avec la France : un Français ne trouvera pas ce prix légitime. On est tellement habitué à l’idée « Internet = gratuit » qu’acheter un manga au format numérique, sauf si on est coincé une heure dans un train tous les matins, peu de personnes achèteront du manga numérique.
Sans compter que notre population est nettement moins nombreuse que celle du Japon. Même si certains franciliens prennent les transports pour travailler à la capitale en semaine, leur nombre ne suffira clairement pas à faire décoller ce marché.
Les éditeurs s’efforcent de proposer une offre légale parce qu’il existe une demande, et d’autres comme la plateforme Mangas.IO font l’essai d’un modèle à la Netflix avec lecture à volonté et abonnement mensuel. Mais ils ont encore trop peu de partenariats pour que ça puisse prendre plus d’ampleur.
Les auteurs qui ont fait de lui le traducteur qu’il est aujourd’hui
Vous êtes un traducteur phare des éditions Kana depuis le début de votre carrière. Vous avez notamment traduit avec eux les titres du très apprécié Inio ASANO, dont Dead Dead Demon’s Dededededestruction, avec lequel vous avez remporté le prix de traduction Konishi l’année dernière. En tant que traducteur, diriez-vous qu’il se démarque aussi des autres lorsque vous travaillez sur ses titres ? Et si oui, qu’est-ce qui fait sa singularité selon vous ?
On peut effectivement dire que Asano est un mangaka atypique, autant dans ses dessins que dans sa narration. C’est un auteur que j’ai découvert quand il publiait des histoires courtes dans le Sunday Gene-X de Shogakukan, et ce que je lisais de lui me donnait encore plus l’impression de vivre au Japon. J’avais l’impression de pouvoir rentrer dans les maisons, de voir les jeunes salarymen qui se trainaient pour aller bosser le matin ou de pouvoir lire dans la tête des Japonais qui se trouvaient autour de moi dans le train car ils correspondaient aux personnages qu’il avait dessinés. Dans ses histoires, on trouve de gros pavés noirs de narration qui nous font rentrer dans la tête des personnages : c’est ce point qui fait de Inio Asano un auteur très particulier.
En plus de ça, si l’on connaît un peu Tokyo, on se rend compte que quasiment toutes ses histoires se déroulent dans le quartier autour de son studio. Dans une interview, il expliquait qu’il était assez casanier et qu’il n’aimait pas faire de longs trajets donc quand il allait faire du repérage, il le faisait rarement à plus d’un kilomètre de chez lui. Pour moi, ça donne à ses histoires une forme de poésie.
Dans une autre interview, vous avez dit que cet auteur n’avait pas encore donné toutes les informations clés de son histoire. Comment un traducteur arrive à gérer ce problème ?
On n’y arrive pas… (Rires)
La seule solution serait d’avoir un contact avec l’auteur et de pouvoir lui poser les questions en temps réel, mais ce n’est pas possible. On peut se retrouver en difficulté et se tromper sur ce que voulait dire l’auteur, mais heureusement ce n’est pas à chaque page ou à chaque tome. C’était le cas dans le tome 8 de Dead Dead Demon’s Dededededestruction, avec un twist dans l’histoire qui a remis en cause absolument tout ce que l’on pensait depuis le début.
Quand j’ai vu ce twist ma réaction a été très simple : « … Eh m*rde. » (Rires)
C’était difficilement rattrapable, l’auteur avait repris des passages des premiers tomes et en donne une interprétation qui nous conduit au twist. .
Il est impossible de le savoir à l’avance et de gérer à 100% ce genre de choses, il faut juste y aller et croiser les doigts pour que ça colle.
La tentation quand on traduit un manga, c’est de trop adapter pour que ça soit le plus naturel possible en français. On peut le faire quand la série est terminée, mais quand ce n’est pas le cas, on est obligé de prendre des réserves. Donc, pour éviter de se retrouver coincé, il faut éviter de trop s’éloigner du texte, ce qui est aussi une difficulté supplémentaire. Le japonais étant une langue agglutinante, il n’y a rien de pire qu’une phrase traduite en français qui transpire le japonais. Mais c’est là aussi tout l’intérêt d’avoir de bons éditeurs français pour nous accompagner.
Si vous deviez nous citer trois auteurs qui vous ont marqué et ont été importants dans votre carrière, lesquels seraient-ils ?
Ne citer que trois noms, c’est très difficile… Il y a énormément d’auteurs incroyables.
Pour commencer, je dirais Katsuhiro ÔTOMO. Je pense qu’il est difficile de dissocier des œuvres de la période à laquelle on l’a lu. Si l’on relit un livre ou une bande dessinée qui nous a marqué à l’adolescence par exemple, il va nous marquer de la même manière. Chaque fois que j’ai les tomes de Akira en main, je fais un saut dans le temps et l’émotion reste la même qu’à l’époque.
Même si je n’ai jamais travaillé sur les titres d’ÔTOMO, il est ce qui a fait de moi le traducteur, le lecteur et même la personne que je suis aujourd’hui.
Ensuite, Akira TORIYAMA, bien évidemment. C’est très difficile de dire qu’on n’aime pas Toriyama, même s’il n’a pas forcément joué de rôle sur ma carrière de traducteur. Je ne peux pas ne pas le citer.
Enfin, le troisième serait Mitsuru ADACHI. Touch était la toute première série que j’ai achetée en japonais. J’avais été profondément marqué par l’anime diffusé dans les années 90. J’avais été surpris par sa narration, alors que je ne connaissais rien au baseball, je me suis surpris à m’y intéresser et à aimer ça. Dans les mangas d’Adachi, le découpage est une vraie science, et dans Touch, ce qu’il fait vivre à l’un de ses personnages principaux m’avait littéralement bouleversé. Le lecteur de BD franco-belges classiques que j’étais, pas habitué à ça, ne s’en est jamais vraiment remis !
Je devrais sûrement aussi parler de Naoki URASAWA. Et Jirô TANIGUCHI. Et Taiyô MATSUMOTO. Et Hiro MASHIMA. Et OBATA & OHBA. Et Yoshitoki OIMA. Et Jun MAYUZUKI. Et…
Comme je l’ai déjà dit, il y a beaucoup d’auteurs fantastiques, dans tous les genres, shônen, shôjo, seinen, que ce soit ceux d’il y a 10 ans en arrière ou ceux d’aujourd’hui. Mon top 3 n’est pas tout jeune, mais disons que c’est une manière de témoigner du respect pour ceux qui ont fortement contribué au boom du manga en France !
Vous avez créé l’atelier 501 ici sur Tokyo pour que des auteurs français et japonais puissent collaborer ensemble. Pourriez-vous nous parler un peu de ce projet ?
C’est un projet qui s’était fait assez naturellement. Il se trouve que Yves Schlirf, le directeur de Kana essayait toujours de rapprocher la bande dessinée franco-belge au manga. Et lorsqu’il voyageait au Japon, il emmenait souvent des auteurs français ou belges avec lui pour leur faire découvrir le Japon et les mangas. Un jour il est parti avec Jean-David Morvan, scénariste de BD et co-auteur de Sillage, qui était déjà fan de mangas à l’époque.
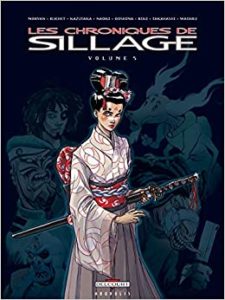
Les chroniques de Sillage – Edition spéciale en collaboration avec six auteurs japonais ©Jean David Morvan et Philippe Buchet – Delcourt
Lorsque Yves nous a présentés, on s’est liés d’amitié très rapidement ce qui nous a conduit à discuter du projet d’implanter la BD franco-belge au Japon. Jean-David a fini par venir de plus en plus souvent au Japon, jusqu’à y passer 6 mois par an, voire davantage. Jusqu’au jour où on a imaginé un atelier commun pour pouvoir travailler ensemble sur le projet et en faire quelque chose de concret. Le dessinateur de Sillage Philippe Buchet allait aussi venir s’installer au Japon avec sa femme. Grâce à ça, le travail à l’Atelier s’est fait tout naturellement et l’on s’est efforcé de proposer des œuvres japonaises en France et vice versa.
Pendant 4 ans, en plus de travailler chacun de notre côté, on a collaboré sur quelques œuvres qui rassemblaient auteurs japonais et français, comme Mon année, de Taniguchi et Jean-David, Le Petit Monde, avec Toru TERADA ou encore un tome hors-série de Sillage réalisé avec l’aide de six auteurs japonais qui ont travaillé à l’atelier.
L’Atelier s’est arrêté au bout de quatre ans car Philippe Buchet devait rentrer en France avec sa compagne, et les coûts de fonctionnement de l’Atelier étaient trop importants pour seulement Jean-David et moi-même. On n’avait malheureusement pas réussi à trouver un mode de fonctionnement économique stable et viable. Donc l’aventure a pris fin en 2010. On aurait tous aimé prolonger l’expérience, mais de toute façon, avec la triple catastrophe de 2011 (séisme, tsunami, accident nucléaire), je pense qu’il aurait été très compliqué de continuer.
L’apparition du COVID-19 a chamboulé la vie et les projets de beaucoup de monde. Quelles ont été les répercussions sur votre métier ?
Je ne peux pas encore répondre précisément à cette question pour la simple raison que l’on ne sait pas encore quelles répercussions réelles cela aura eu sur le chiffre d’affaires des éditeurs cette année. Mais il est fort à parier que d’ici un an ou deux, les éditeurs freinent l’achat de nouvelles licences, ce qui fera moins de travail pour les graphistes ou les traducteurs. Pour l’instant, mon travail reste inchangé, mais l’avenir est incertain.
Durant le confinement, un seul point technique avait un peu changé, c’était que les bouquins annotés et annexés n’étaient plus envoyés mais scannés (plus exactement, on numérotait le manga papier à la main, on photographiait les pages avec nos smartphones et on partageait ça avec les éditeurs). Et je dois dire que j’ai bien apprécié ce petit changement, on gagne du temps, de l’argent et c’est sûrement aussi mieux pour l’écologie.
Un petit mot pour les passionnés de mangas qui souhaitent se lancer dans l’aventure et devenir traducteur ?
A priori, je leur dirais de choisir un autre métier, il est inutile de venir prendre le mien. Plus sérieusement, à ceux qui souhaitent devenir traducteurs, je dirais d’essayer d’imaginer le métier de traducteur dans plusieurs années, disons 5 ans, à peu près, et en fonction de ça, de choisir la formation la plus adaptée qui leur permettra d’être le meilleur traducteur possible dans 5 ans. Comme on l’a évoqué plus tôt, il est possible que le métier du traducteur de manga d’aujourd’hui, qui part de zéro depuis le japonais, change du tout au tout, et qu’à l’avenir cela consiste davantage en un travail de correction, relecture, réécriture, adaptation.
Il est important de s’interroger alors pour savoir si c’est ce métier-là qu’ils ont envie de faire. On aura toujours besoin de gens qui maîtrisent le japonais et le français. Une intelligence artificielle n’arrivera jamais (enfin, pas avant une petite décennie en tout cas) à traduire parfaitement un texte en français et les éditeurs auront sûrement besoin de traducteurs compétents en adaptation, en relecture. Traducteur de manga en 2020 et traducteur de manga en 2025 ou 2030, ça ne veut probablement pas dire la même chose ! Je pourrais aussi évoquer la démocratisation des simultrads, qui contraint à travailler dans des délais très courts, avec une exigence de qualité identique, mais je vais m’abstenir sinon vous allez penser que je cherche à décourager tout le monde !
La vérité, c’est que les vrais passionnés n’ont besoin d’aucun conseil, ils iront au bout de leur idée, quoi qu’on leur dise. N’est-ce pas ?
Certainement !
Un très grand merci Monsieur Desbief pour cette interview passionnante !
Il nous tarde de lire la suite de Hunter x Hunter, un nouveau titre de Inio ASANO et les nouveaux projets qui vous seront confiés. En espérant que cette rencontre vous aura plu autant qu’à nous, n’hésitez pas à partager avec nous en commentaire !


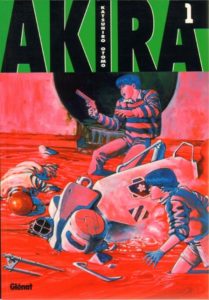
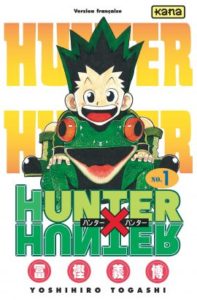

















Bonjour,
Les traducteurs techniques n’utilisent pas la traduction automatique (qui donne encore d’assez mauvais résultats aujourd’hui, même sur des textes plus transparents que la fiction), mais des logiciels d’aide à la traduction (TAO) : séparation en segments et mémoire des traductions déjà faites sur un terme, une expression, qui permet d’être raccord avec les autres traducteurs, par exemple.