Akira YOSHIMURA : écrire sur l’Histoire, la mort, avec précision
Dans la série des grands classiques de la littérature japonaise, et à l’occasion de la publication de deux de ses livres aux éditions Actes Sud, Journal du Japon vous invite à découvrir ou redécouvrir Akira YOSHIMURA.
Akira YOSHIMURA, la Voie de l’écriture
Né en 1927 à Tokyo dans une famille nombreuse relativement aisée, Akira Yoshimura connut la guerre adolescent et fut marqué par la mort d’un de ses frères dans les combats en Chine. Il consacra d’ailleurs plusieurs de ses romans et nouvelles à la guerre, en racontant par exemple l’horreur de la bataille d’Okinawa dans laquelle tant de soldats et de civils ont perdu la vie (avec Mourir pour la patrie, où il met en scène un adolescent de 14 ans enrôlé en 1945 avec d’autres camarades de collège, qui vit l’horreur absolue, se cachant au milieu des cadavres, l’estomac désespérément vide, avec pour seule issue la mort ou la reddition – pire que la mort pour les soldats japonais), ou écrivant sur la délicate question des crimes de guerre, sujet longtemps occulté dans la société japonaise (avec La Guerre des jours lointains dans lequel un lieutenant en fuite est recherché pour crime de guerre et hanté par les images des soldats qu’il a exécutés). Un autre fait historique marquant, Le Grand Tremblement de Terre du Kantô (de 1923) est le titre d’un livre exceptionnel, dans lequel le lecteur peut sentir l’énorme travail de documentation de l’auteur ainsi que sa plume précise pour décrire le désastre d’une ampleur inédite sous forme d’une fresque terrifiante (voir plus bas).
Un autre thème qui habite tous les livres d’Akira YOSHIMURA, même lorsque la guerre n’est pas là : la mort. Mais jamais décrite de façon glauque, morbide, obsessionnelle … juste appréhendée sous différents angles. Une jeune femme de seize ans qui vient de mourir observe ce que les hommes font à son corps donné à la science, avant de finir sous forme de cendres sur une étagère du colombarium de l’hôpital dans La jeune fille suppliciée sur une étagère. Un homme qui rêve de pouvoir transformer le corps humain après la mort en fossile brillant comme du mica dans Un spécimen transparent. De jeunes hommes qui veulent mourir ensemble en se lançant d’une falaise comme des oiseaux. Des villageois qui font du feu sur la plage pour que les bateaux chargés de vivres viennent s’écraser sur les rochers, afin de pouvoir manger et ne pas mourir de famine dans ce village isolé, coincé entre mer et montagne (dans Naufrages). La mort est là, elle n’est ni une fin, ni un début, juste un fait que l’auteur décrit avec méticulosité, qu’elle soit voulue ou subie, liée à des phénomènes naturels ou causée par les hommes.
Au centre de ses récits se trouvent les liens familiaux, mais également les liens sociaux, et leur résistance (ou non) aux épreuves et traumatismes subis (par exemple pendant la guerre ou suite à tremblement de terre). Et c’est comme un album photo qui s’ouvre sous les yeux du lecteur.
Un dîner en bateau : nouvelles intimes sur la maladie, la guerre, la mort …
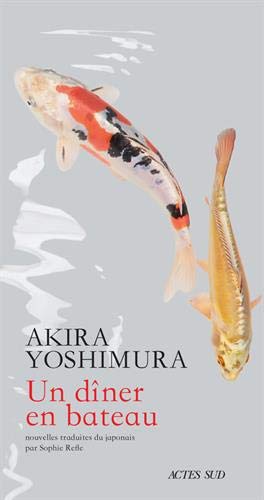 Dans ce recueil de dix nouvelles, l’auteur mêle les différents thèmes qui habitent ses livres. Le narrateur (les nouvelles sont écrites dans le registre du shishosetsu, genre littéraire japonais proche de l’autofiction) y entremêle présent et passé au fil des événements qui se croisent, se reproduisent, se répondent d’une nouvelle à l’autre. Un narrateur qui est à la fois dans l’action, la contemplation, l’écoute, le partage de moments et de souvenirs.
Dans ce recueil de dix nouvelles, l’auteur mêle les différents thèmes qui habitent ses livres. Le narrateur (les nouvelles sont écrites dans le registre du shishosetsu, genre littéraire japonais proche de l’autofiction) y entremêle présent et passé au fil des événements qui se croisent, se reproduisent, se répondent d’une nouvelle à l’autre. Un narrateur qui est à la fois dans l’action, la contemplation, l’écoute, le partage de moments et de souvenirs.
Il y a les souvenirs de la guerre et plus particulièrement des bombardements qui détruisent les maisons, tuent les habitants qu’ils soient de très jeunes enfants, des adultes dans la force de l’âge ou des vieillards, qui marquent à vie ceux qui ont survécu et pour lesquels il suffit d’un bruit, d’une image pour raviver la douleur enfouie pendant des dizaines d’années.
Ainsi, dans Poissons rouges, l’auteur se souvient qu’adolescent à la fin de la guerre, les gens demandaient à son père de leur donner des poissons rouges dont la rumeur disait alors qu’ils étaient des talismans les préservant des bombardements. L’image de leur maison détruite et du bassin aux poissons vide et fissuré suite à un bombardement refait surface lorsqu’il achète un poisson et un aquarium traditionnel en forme de citrouille des dizaines d’années plus tard.
Dans Cigale du Japon, c’est aux funérailles d’une cousine qu’il se rappelle que celle-ci avait perdu sa fille âgée de quelques années asphyxiée au cours d’un incendie suite à un bombardement. Elle se souvenait des décennies plus tard du chant insupportable des cigales cette nuit-là.
Lors d’Un dîner en bateau, le narrateur, qui va assister à un feu d’artificie depuis un bateau restaurant, se souvient des rivières et canaux qui, pendant la guerre, étaient encombrés de cadavres qui formaient des radeaux, puis de la pureté de l’eau juste après la guerre, les usines ne fonctionnant plus (ayant été détruites ou n’ayant plus de matières premières pour fonctionner).
La maladie est également au cœur de presque toutes les nouvelles. Le narrateur va en effet rendre visite à des malades ou participer à des cérémonies funéraires. Cousins, tantes, oncles, frères, il semble que les cancers se multiplient dans son entourage. Ces visites ou ces cérémonies sont l’occasion d’évoquer les souvenirs communs, de parler de choses restées non dites pendant des décennies, de sentir la fragilité de la vie (les titres font d’ailleurs souvent référence aux saisons pour marquer le temps qui passe et les vies qui s’achèvent : Début de printemps, Bientôt l’automne, Pluie de printemps). L’occasion également d’évoquer les liens qui se distendent au fil du temps, les personnes oubliées, pas vues pendant des dizaines d’années, la solitude qui s’installe, le vieillissement qui fait se multiplier les soucis de santé.
La mort dans la famille :
Confronté dès l’enfance à la mort de ma grande sœur, j’ai ensuite perdu ma grand-mère, un premier frère aîné, mes parents, un deuxième frère aîné et mon frère cadet. Cela me rend peut-être insensible à celle de personnes qui ne font pas partie de ma famille. Elle ne m’émeut pas profondément. Le décès de ma cousine n’était pas une surprise, et j’avais senti une certaine distance avec l’émotion de mon cousin.
La souffrance, les cancers :
Il y a quatre ans, mon frère cadet a enduré de terribles souffrances avant de mourir d’un cancer du poumon, et je pose toujours cette question quand j’apprends que quelqu’un est décédé de cette maladie. Chaque cas est différent : chez nous, le troisième de ma fratrie et mon père ne se sont pas plaints de grandes douleurs, mais ma mère a beaucoup souffert. Elle était devenue dépendante à la morphine peu de temps avant sa mort. Il y a beaucoup de cancers dans ma famille proche et élargie, et si mon cousin a raison de dire que nous sommes d’une lignée fragile à cet égard, j’ai toutes les raisons de craindre d’en avoir un aussi. Mourir est inévitable, mais je voudrais ne pas souffrir.
La nouvelle L’échantillon est troublante. Elle raconte la thoracoplastie qu’a subie le narrateur à l’âge de vingt ans. Les médecins à l’époque enlevaient des cotes pour soigner la tuberculose. Une opération très douloureuse qui l’a profondément et qui se rappelle vivement à lui (avec le souvenir d’autres malades dont une jeune femme qui avait subi deux fois l’opération, avec un total de douze cotes enlevées !) lorsque les médecins, trente-huit ans plus tard, lui proposent de voir ses cotes qui ont été conservées dans du formol. Le lecteur en sort très secoué, car comme à son habitude, Akira YOSHIMURA lui livre les plus infimes détails, de la cassure visible sur les os aux cris des malades opérés !
Voici quelques exemples des descriptions qui illuminent le livre, comme des photos prises sur le vif :
Le mont Fuji :
Le mont Fuji était nettement visible, ce qui est rare à Tokyo. Ses pentes de bol renversé étaient baignées de mauve. Des lumières commençaient à apparaître aux fenêtres des buildings de la ville, les réverbères s’allumaient. Le ciel à l’ouest était encore clair, et la silhouette des montagnes se distinguait au loin.
La circulation était intense sur l’autoroute et la voiture avançait de quelques mètres pour s’arrêter aussitôt. L’homme dans la quarantaine, coiffé d’un passe-montagne, au volant de la camionnette chargée de pruniers en fleurs qui roulait à côté de nous tournait de temps en temps la tête faire le couchant.
Un paysage de pluie :
Puis j’ai longé un champ clôturé, d’un vert intense sous la pluie, au fond duquel se dressait une grande bâtisse, probablement une ferme, entourée du vermillon éclatant d’azalées en fleur.
Une mante religieuse :
Ses yeux à facettes, qui ressemblaient à des étamines de lys tigré, ne bougèrent pas quand j’approchai mon visage, qu’elle m’ait ou non vu. La pince de sa patte avant baissée avait la transparence d’une agate. Elle lissait parfois son aile brun clair, visible au point de jonction de la patte arrière, laquelle avait l’aspect d’une scie à découper.
Un receuil de nouvelles doux-amer, un très bel ouvrage, sensible et personnel, idéal pour découvrir l’auteur.
Le Grand Tremblement de Terre du Kantô
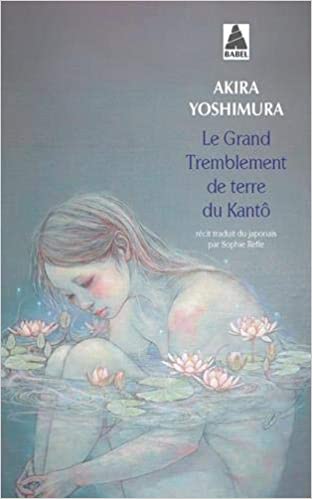 Dans ce livre de près de trois cents pages qui sort en cette fin d’année en format poche, l’auteur livre un récit documentaire impressionnant par la quantité de données et de témoignages, par la structuration thématique et par la retranscription des faits de la façon la plus juste possible.
Dans ce livre de près de trois cents pages qui sort en cette fin d’année en format poche, l’auteur livre un récit documentaire impressionnant par la quantité de données et de témoignages, par la structuration thématique et par la retranscription des faits de la façon la plus juste possible.
Il explique le pourquoi de ce livre dans la postface :
« Mes parents vécurent le grand tremblement de terre du Kantô à Tôkyô et leurs récits ont accompagné mon enfance. La confusion des esprits décrite par mes parents m’horrifiait. La panique que ressent l’homme face à ses semblables lorsqu’il est confronté à une catastrophe est ce qui m’a poussé à écrire ce récit ».
Le récit commence à la fin de l’année 1915, un tremblement de terre qui réveille les habitants de Tokyo vers trois heures du matin, qui dure longtemps, avec de nombreuses répliques. Le précédent tremblement de terre date de 1855 et a fait de nombreuses victimes, surtout à cause de l’incendie survenu alors. On assiste alors à la bataille entre le célèbre sismologue Ômori (qui a inventé le sismomètre qui porte son nom, un pendule horizontal mécanique d’enregistrement), qui essaie alors de rassurer la population, et Imamura qui prédit un séisme dans les cinquante ans à venir, et qui avait écrit dès 1905 un article expliquant que Tokyo est plus fragile qu’Edo par rapport au séisme et que les risques d’incendies y sont encore plus élevés (lampes à pétrole, rues étroites, canalisations d’eau qui peuvent se rompre).
D’autres petits séismes ont lieu en 1920, 21, 22.
Puis arrive le jour tragique du 1er septembre 1923 et ses 200 000 victimes. Le lecteur voit les aiguilles des sismomètres qui jaillissent des boîtiers, la terre qui se soulève par endroits, s’affaisse à d’autres, et la durée des tremblements qui semble infinie ! Glissements de terrain, effondrement de bâtiments (le grand bouddha de Kamakura s’enfonce de cinquante centimètres dans le sol et avance d’une quarantaine de centimètres), ponts et voies ferrées détruites … Les témoignages livrés au fil des pages sont édifiants !
Un écolier raconte :
« Je voulais à tout prix rentrer chez moi, j’étais prêt à y aller en rampant, mais je ne pouvais pas car la rue était obstruée par des gravats. J’avais peur d’être enseveli si la maison à côté de moi s’effondrait, et j’ai réussi à rejoindre tant bien que mal l’avenue qui passe devant le Hifukushô. Là aussi, plusieurs maisons s’étaient écroulées.
Je me suis retenu à un arbre qui bordait l’avenue. Il tanguait, mais j’étais certain que je mourrais si je le lâchais. »
Puis comme prévu par le professeur Imamura, les incendies ont commencé à se répandre dans toute la ville. Il était en effet midi lorsque le séisme a commencé et les personnes qui préparaient les repas sont sortis en laissant les fourneaux allumés, et en emportant du mobilier et autres objets personnels inflammables qui attisèrent les feux, accompagnés par un vent ravageur. Des fleuves de feu et des conflagrations furent visibles dans tout Tokyo.
« Les flammes firent rage pendant 42 heures, brûlant en moyenne 82,4 hectares à l’heure, soit 1,4 hectare à la minute, et plus de 227 mètres carrés à la seconde.
La vitesse à laquelle elles progressèrent s’explique avant tout par les bagages des réfugiés. Très vite, les rues furent remplies de gens partis de chez eux avec ce qu’ils avaient de plus précieux sur leur dos, sur des charrettes à bras ou même des carrioles tirées par des chevaux, et leurs bagages prirent feu au contact des flammèches transportées par le vent. Beaucoup moururent brûlés vifs,
incapables d’échapper aux flammes à cause de leurs bagages.
Les incendies se propagèrent aux fils électriques et embrasèrent les maisons le long des rues. »
Akira YOSHIMURA détaille alors les catastrophes qui se déroulèrent : les 38 000 morts sur le site de Hifukushô (un ancien terrain militaire qui devait devenir une école avec terrain de sport), un grand espace dans lequel de très nombreuses personnes vinrent s’entasser avec meubles et nattes de paille qui s’enflammèrent, créant de véritables tourbillons de feu qui soulevaient objets et êtres vivants et où seulement 2000 personnes sur les 40 000 présentes survécurent au brasier. Leurs témoignages sont effrayants !
« Le feu rampait sur le sol et se propageait aux vêtements de ceux qui tombaient. D’autres marchaient sur leurs corps qui éclataient sous leur poids, ou peut-être à cause de la chaleur, et les entrailles giclaient.
Bientôt des bourrasques de vent provoquèrent de véritables cyclones ardents dus au phénomène des tourbillons de feu. Ils soulevèrent de terre des plaques de tôle, des couvertures, des meubles et parfois des êtres humains et des chevaux. »
Au parc de Yoshiwara, de nombreuses prostituées moururent en se noyant dans l’étang pour échapper aux flammes. Le parc d’Ueno fut quant à lui un refuge salvateur (les bagages y furent interdits et la foule aida les pompiers). Un quartier de l’arrondissement de Kanda fut sauvé par ses seuls habitants qui firent des chaînes de seaux depuis une canalisation non rompue et une rivière et détruisirent une rangée de maison pour faire un coupe-feu.
La deuxième partie du livre est consacrée au « deuxième drame », celui du « trouble des esprits ». L’auteur détaille les rumeurs qui circulèrent autour d’attaques de Coréens et les milices d’autodéfense qui se créèrent et tabassèrent et tuèrent plusieurs centaines de Coréens (les chiffres officiels parlent de 231 morts mais les enquêtes indépendantes permettent d’avancer le chiffre de 2613, sans compter les milliers de cas de violence). Il y eu même des Japonais tués, pris pour des Coréens. Tout est expliqué : la naissance des rumeurs, la façon dont elles se sont diffusées, essentiellement par le bouche à oreille, par des témoignages farfelus non vérifiés et publiés dans les journaux, par certaines instances de l’État (même s’il y eut de nombreux communiqués pour tenter de rétablir la vérité et d’apaiser la population). L’auteur écrit également sur la presse et la censure, et sur le meurtre d’Ôsugi Sakae (tué avec sa femme et son neveu de six ans par la gendarmerie militaire). Cet homme qualifié d’« anarchiste le plus influent du Japon » fut étranglé par le capitaine Amakasu qui vouait une haine viscérale aux socialistes. Son procès est retranscrit dans le livre et permet de comprendre l’ambiance qui régnait alors autour du communiste, du socialisme, du syndicalisme …
Le réquisitoire du procureur fait froid dans le dos : « Tout en affirmant qu’il était inacceptable dans un pays de droit de tuer qui que ce fût, même un socialiste ennemi du bien public, il concluait qu’il fallait tenir compte du fait que le capitaine Amakasu avait été mû par de nobles motifs, sans aucune considération personnelle. » Akamasu fut condamné à dix ans de prison et sortit au bout de trois ans.
Une dernière partie est consacrée à la reconstruction. Il faut d’abord enlever les cadavres en putréfacion ou glonflés d’eau dans les rivières (le risque sanitaire étant élevé en raison des fortes chaleurs encore présentes), les incinérer, s’occuper de l’hygiène des réfugiés entassés dans des baraquements, surveiller les pilleurs …
Les dernières pages mettent en avant les progrès réalisés suite à ce terrible tremblement de terre : rues plus larges, constructions antisismiques, un plan de reconstruction de la ville qui fut l’obsession du professeur Ômori, gravement malade lorsqu’il rentre d’Australie le 4 octobre – il avait quitté le Japon en juillet) jusqu’à sa mort le 8 novembre 1923.
Un ouvrage terrifiant et passionnant, d’une richesse exceptionnelle pour comprendre cette catastrophe marquante du début du XXème siècle.
Les livres d’Akira YOSHIMURA sont à retrouver sur le site des éditions Actes Sud.
Un auteur qui manie la plume avec précision et la met au service de récits souvent sombres, documentaires historiques ou romans et nouvelles mêlant faits historiques, expériences personnelles et légendes japonaises. Un auteur marquant du XXe siècle.













